Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises,
Je buvais, accroupi dans quelque bruyère
Entourée de tendres bois de noisetiers,
Par un brouillard d’après-midi tiède et vert.
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise,
Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert.
Que tirais-je à la gourde de colocase ?
Quelque liqueur d’or, fade et qui fait suer.
Tel, j’eusse été mauvaise enseigne d’auberge.
Puis l’orage changea le ciel, jusqu’au soir.
Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches,
Des colonnades sous la nuit bleue, des gares.
L’eau des bois se perdait sur des sables vierges,
Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares…
Or ! tel qu’un pêcheur d’or ou de coquillages,
Dire que je n’ai pas eu souci de boire !
Mai 1872
Arthur Rimbaud, Derniers vers
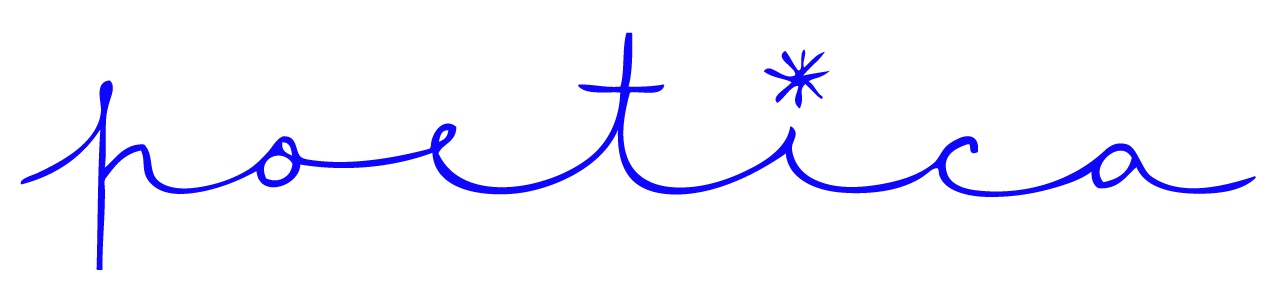

Etrange poème, l’un des plus émouvants des « Derniers vers » de 1872, l’un des plus insolites aussi, qui met en scène l’univers à la fois onirique et naturaliste du poète, l’un de ceux où l’on ressent le mieux sa déréliction jusqu’à pouvoir presque la partager, où l’on lit le mieux sa quête éperdue d’une « source » où il pourrait désaltérer sa soif inextinguible d’être, d’amour (c’est tout un), de vérité (à « posséder dans une âme et un corps »), un de ceux qui peut nous tirer une « larme » sincère devant tant de solitude, tant d’abandon, tant d’attente d’un idéal toujours déçu, avec l’expression in fine d’un regret poignant, inconsolable, tel qu’on peut le lire dans le dernier vers qui -réécrit de manière plus explicite dans « Alchimie du Verbe », poème anthologique d’ « Une saison en enfer »- donne : « Pleurant, je voyais de l’or et ne pus boire »…
Le poète est « loin », mais cet éloignement n’est pas seulement géographique : il est loin de tout, loin de lui-même, cherchant à boire dans une nature primitive, un soir d’orage qui va changer le ciel et peut-être aussi sa vision des choses : ainsi, « enfant, certains ciels ont affiné mon optique » …
Dans les deux premières strophes, avant l’orage, dans une sorte de dédoublement que l’on retrouve ailleurs (cf. : « l’aube et l’enfant tombèrent au bas du bois», de « Aube »), Rimbaud le Poète voit Arthur accroupi, seul, dans quelque bruyère, à boire une « liqueur d’or, fade » (allusion aux « boissons tiédies », ici : une bière ?), s’entraînant à son hallucination première par l’alcool : c’est la phase du « dérèglement de tous les sens », la phase qui va rapidement conduire à une impasse physique et psychique, même si elle aura pu permettre de déclencher le processus de création poétique, de forcer la vision à se produire, pour ouvrir la voie à l’invention d’un nouveau verbe, de nouveaux rythmes adaptés à la nouvelle réalité perçue, avant que les mots ne prennent à leur tour leur indépendance, ne se libèrent de l’influence du « dérèglement » préliminaire et anticipent par eux-mêmes la vision, soient eux-mêmes « en avant de l’action », en place et lieu de l’alcool, de la drogue ou de l’amour violent devenus inutiles, comme on le verra dans les « Illuminations » écrites en prose.
Dans les deux dernières strophes, pendant le passage de l’orage, le poète décrit la scène grandiose et réalise in fine qu’Arthur ne pouvait pas voir, ni donc « boire », tout concentré qu’il était sur le travail de « dérèglement » (« tel un chercheur d’or et de coquillages ») : avec un décalage et une conscience réfléchie qui sont ceux de l’écriture, il compose une œuvre qui est « la pensée chantée et comprise du chanteur » et n’en reste pas à la seule description…
Les « Derniers vers » présentent souvent cette dichotomie entre le dérèglement appliqué à la lettre avec un certain succès par Arthur en mai-juin 1872, la recherche de la violence (y compris et jusque dans l’amour) au péril de sa santé physique et mentale, « l’œuvre au noir », et la critique déjà consciente du « système » par Rimbaud, « l’œuvre au blanc » (l’arrivée de l’esprit), qui opère une mise à distance de la Voyance dès cette époque, un pied posé dans la poésie objective et apaisée des « Illuminations » à laquelle participe déjà largement la poétique des « Derniers vers », et avant la condamnation sans appel d’ « Une Saison en enfer » en 1873 : Rimbaud, poète de la Raison et de la conscience, sait « assister à l’éclosion de sa pensée » et la retranscrire avec une précision limpide, sans le pathos « romantique »…
Ici, le paysage initialement « vert » devient « noir » et « la nuit bleue », la tempête éclate et suscite des visions grandioses que l’alchimie du verbe traduit avec des mots évoquant un paysage mi-naturel (« des pays noirs, des lacs, des perches »), mi-urbain, comme on l’a vu dans « Aube », avec l’enfant courant derrière la lumière, sortant du bois, traversant la grand ’ville impersonnelle avec ses clochers et ses dômes, et courant sur les « quais de marbre » …
Toujours ce même « paysage » évoquant la solitude infinie, la nudité, l’étrangeté, parlant de ces lieux de passage par excellence que sont les « colonnades » (les trombes d’eau évoquant des portiques antiques ?) et de départ que sont les « gares », lieux que l’on traverse sans s’arrêter, où des êtres anonymes se croisent sans jamais se rencontrer…
Peut-on y voir là la préfiguration du destin de Rimbaud, « fileur éternel des immobilités bleues » … et jaune sable ?
Les vers sont des hendécasyllabes, les rimes variées (rimes pour l’œil, rimes androgynes, rimes diphtonguées, assonances et contre-assonances etc.) se perdent par l’indétermination de leur forme dans le blanc de la page vierge, elles évoquent cette indétermination du paysage, sa fluidité, dessinent ce lieu perdu, de nulle part, noyé dans le « brouillard » du début, puis effacé sous les trombes d’eau (« les colonnades, les perches » ? ) et les grêlons (« les glaçons » ?) : « ce ne peut être que la fin du monde en avançant »…
Mais, comme souvent chez Rimbaud, les derniers vers apportent un éclairage décisif au poème, après ce « Or !» de rupture en attaque de l’avant-dernier et quinzième vers qui fait l’aveu en « or » de l’échec de la Voyance et nous invite à revenir pleinement au réel…
« Comédie de la soif », qui est contemporain à « Larme », donne une clé de lecture au poème dans sa conclusion : « Mais fondre où fond ce nuage sans guide », mais surtout « Alchimie du verbe » : « Pleurant, je voyais de l’or -et ne pus boire. », que l’on peut lire comme l’exégèse du dernier vers, avec une allusion directe à la « Larme » mystérieuse du titre.
Arthur accroupi, perdu dans « quelque bruyère » au bord de l’Oise, cherche à voir à tout prix « de l’or » en s’adonnant à l’alcool, mais tel le légendaire roi Midas voilà que tout ce qu’il touche (et voit) se change en or : la méthode semble avoir réussi dans un premier temps, mais Arthur va trop loin et lâche la proie pour l’ombre jusqu’à pleurer de son infirmité, de sa désormais cécité…
« Larme » se veut être un retour « à la proie » : au bonheur par la sincérité des larmes !
Le « dérèglement » a permis au poète dans un premier temps de rompre avec l’habitude, de déclencher l’«alchimie», de trouver les mots, d’inventer de nouveaux rythmes, de « fixer des vertiges », de « voir quelquefois ce que l’homme a cru voir », mais « le système tenu», trop tenu, l’a conduit sur une fausse piste : la Vision de l’or, l’hallucination tant cherchée en voulant (se) faire violence, l’empêche finalement de voir l’essentiel comme dirait le Petit Prince, le prive de boire à la source de vie, et cette source n’est pas l’Oise, n’est pas la pluie torrentielle du nuage (à cette eau même le gibier boit), non, cette source c’est la fraîcheur de la vision elle-même, c’est la simple Beauté évoquée dans le poème, reconnue ici grâce à une alchimie qui a cessé d’injurier, qui ne cherche plus « de l’or » à tout prix, mais du réel par l’amour, du réel aimé (« l’eau des bois », « les sables vierges », « le vent du ciel » etc.), c’est à dire du « bonheur », qu’il faut « avoir souci » de voir et « de boire », « oh ! favorisé de ce qui est frais »…
Le dérèglement de tous les sens incroyablement dessiné dans chacune de ses oeuvres par l’épatante description de l’ineffable. VRAI ! Rimbaud, la littérale beauté du diable, le voyageur fou, l’implacable trafiquant et l’incomparable poète, incomparable, unique.
Rimbaud est vraiment unique!