Maison de la naissance, ô nid, doux coin du monde !
Ô premier univers où nos pas ont tourné !
Chambre ou ciel, dont le coeur garde la mappemonde,
Au fond du temps je vois ton seuil abandonné.
Je m’en irais aveugle et sans guide à ta porte,
Toucher le berceau nu qui daigna me nourrir.
Si je deviens âgée et faible, qu’on m’y porte !
Je n’y pus vivre enfant, j’y voudrais bien mourir,
Marcher dans notre cour où croissait un peu d’herbe,
Où l’oiseau de nos toits descendait boire et puis,
Pour coucher ses enfants, becquetait l’humble gerbe,
Entre les cailloux bleus que mouillait le grand puits !
De sa fraîcheur lointaine il lave encor mon âme,
Du présent qui me brûle il étanche la flamme,
Ce puits large et dormeur au cristal enfermé
Où ma mère baignait son enfant bien-aimé.
Lorsqu’elle berçait l’air avec sa voix rêveuse,
Qu’elle était calme et blanche et paisible le soir,
Désaltérant le pauvre assis, comme on croit voir
Aux ruisseaux de la bible une fraîche laveuse !
Elle avait des accents d’harmonieux amour
Que je buvais du coeur en jouant dans la cour.
Ciel ! Où prend donc sa voix une mère qui chante
Pour aider le sommeil à descendre au berceau ?
Dieu mit-il plus de grâce au souffle d’un ruisseau ?
Est-ce l’éden rouvert à son hymne touchante,
Laissant sur l’oreiller de l’enfant qui s’endort,
Poindre tous les soleils qui lui cachent la mort ?
Et l’enfant assoupi, sous cette âme voilée,
Reconnaît-il les bruits d’une vie écoulée ?
Est-ce un cantique appris à son départ du ciel,
Où l’adieu d’un jeune ange épancha quelque miel ?
Merci, mon Dieu ! Merci de cette hymne profonde,
Pleurante encore en moi dans les rires du monde,
Alors que je m’assieds à quelque coin rêveur
Pour entendre ma mère en écoutant mon coeur :
Ce lointain au revoir de son âme à mon âme
Soutient en la grondant ma faiblesse de femme ;
Comme au jonc qui se penche une brise en son cours
A dit : » Ne tombe pas ! J’arrive à ton secours. «
Elle a fait mes genoux souples à la prière.
J’appris d’elle, seigneur, d’où vient votre lumière,
Quand j’amusais mes yeux à voir briller ses yeux,
Qui ne quittaient mon front que pour parler aux cieux.
A l’heure du travail qui coulait pleine et pure,
Je croyais que ses mains régissaient la nature,
Instruite par le Christ, à sa voix incliné,
Qu’elle écoutait priante et le front prosterné.
Vraiment, je le croyais ! Et d’une foi si tendre
Que le Christ au lambris me paraissait l’entendre :
Je voyais bien que, femme, elle pliait à Dieu,
Mais ma mère, après lui, l’enseignait en tout lieu.
L’ardent soleil de juin qui riait dans la chambre,
L’âtre dont les clartés illuminaient décembre,
Les fruits, les blés en fleur, ma fraîche nuit, mon jour,
Ma mère créait tout du fond de son séjour.
C’était ma mère ! ô mère ! ô Christ ! ô crainte ! ô charmes !
Laissez tremper mon coeur dans vos suaves larmes ;
Laissez ces songes d’or éclairer les vieux murs
Des pauvres innocents nés dans les coins obscurs ;
Laissez, puisqu’ici-bas nous nous perdons sans elles,
Des mères aux enfants comme aux oiseaux des ailes.
Quand la mienne avait dit : » Vous êtes mon enfant ! «
Le ciel, c’était mon coeur à jour et triomphant ! …
Elle se défendait de me faire savante :
» Apprendre, c’est vieillir, disait-elle, et l’enfant
Se nourrira trop tôt du fruit que Dieu défend,
Fruit fiévreux à la sève aride et décevante.
L’enfant sait tout qui dit à son ange gardien :
– » Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ! «
C’est assez demander à cette vie amère,
Assez de savoir suivre et regarder sa mère,
Et nous aurons appris pour un long avenir
Si nous savons prier, nous soumettre et bénir ! «
Et je ne savais rien à dix ans qu’être heureuse,
Rien que jeter au ciel ma voix d’oiseau, mes fleurs ;
Rien, durant ma croissance aigüe et douloureuse,
Que plonger dans ses bras mon sommeil ou mes pleurs.
Je n’avais rien appris, rien lu que ma prière.
Quand mon sein se gonfla de chants mystérieux,
J’écoutais notre-dame et j’épelais les cieux,
Et la vague harmonie inondait ma paupière ;
Les mots seuls y manquaient, mais je croyais qu’un jour
On m’entendrait aimer pour me répondre : amour !
Les psaumes de l’oiseau caché dans le feuillage,
Ce qu’il raconte au ciel par le ciel répondu,
Mon âme qu’on croyait indolente ou volage,
L’a toujours entendu !
Et quand là-bas, là-bas, comme on peint l’espérance,
Dieu montrait l’arc-en-ciel aux pèlerins errants,
S’il avait ruisselé sur ma vierge souffrance,
La nuit se sillonnait de songes transparents ;
Et sur l’onde qui glisse et plie, et s’abandonne,
Quand j’avais amassé des parfums purs et frais,
En voyant fuir mes fleurs que n’attendait personne,
Je regardais ma mère et je les lui montrais.
Et ma mère disait : » C’est une maladie,
Un mélange de jeux, de pleurs, de mélodie :
C’est le coeur de mon coeur ! Oui, ma fille ! Plus tard,
Vous trouverez l’amour et la vie… autre part. «
Innocence ! Innocence ! éternité rêvée !
Au bout des temps de pleurs serez-vous retrouvée ?
êtes-vous ma maison que je ne peux rouvrir ?
Ma mère ! Est-ce la mort ? … je voudrais bien mourir !
Marceline Desbordes-Valmore
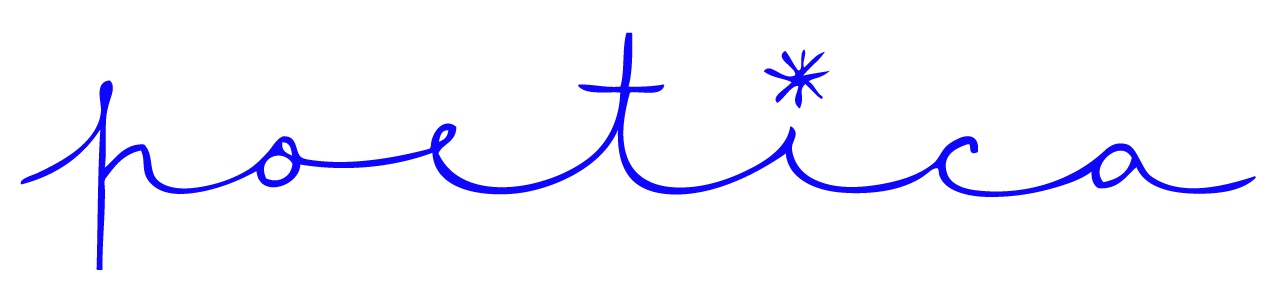

Pour moi, le ton est un peu trop affecté, avec trop de « Ciel ! Dieu ! Oh ! » et cetera.