Le désert est muet, la tente est solitaire.
Quel pasteur courageux la dressa sur la terre
Du sable et des lions ? — La nuit n’a pas calmé
La fournaise du jour dont l’air est enflammé.
Un vent léger s’élève à l’horizon et ride
Les flots de la poussière ainsi qu’un lac limpide.
Le lin blanc de la tente est bercé mollement ;
L’œuf d’autruche, allumé, veille paisiblement,
Des voyageurs voilés intérieure étoile,
Et jette longuement deux ombres sur la toile.
L’une est grande et superbe, et l’autre est à ses pieds :
C’est Dalila, l’esclave, et ses bras sont liés
Aux genoux réunis du maître jeune et grave
Dont la force divine obéit à l’esclave.
Comme un doux léopard elle est souple et répand
Ses cheveux dénoués aux pieds de son amant.
Ses grands yeux, entr’ouverts comme s’ouvre l’amande,
Sont brûlants du plaisir que son regard demande,
Et jettent, par éclats, leurs mobiles lueurs.
Ses bras fins tout mouillés de tièdes sueurs,
Ses pieds voluptueux qui sont croisés sous elle,
Ses flancs, plus élancés que ceux de la gazelle,
Pressés de bracelets, d’anneaux, de boucles d’or,
Sont bruns, et, comme il sied aux filles de Hatsor,
Ses deux seins, tout chargés d’amulettes anciennes,
Sont chastement pressés d’étoffes syriennes.
Les genoux de Samson fortement sont unis
Comme les deux genoux du colosse Anubis.
Elle s’endort sans force et riante et bercée
Par la puissante main sous sa tête placée.
Lui, murmure le chant funèbre et douloureux
Prononcé dans la gorge avec des mots hébreux.
Elle ne comprend pas la parole étrangère,
Mais le chant verse un somme en sa tête légère.
« Une lutte éternelle en tout temps, en tout lieu,
Se livre sur la terre, en présence de Dieu,
Entre la bonté d’Homme et la ruse de Femme.
Car la Femme est un être impur de corps et d’âme.
L’Homme a toujours besoin de caresse et d’amour,
Sa mère l’en abreuve alors qu’il vient au jour,
Et ce bras le premier l’engourdit, le balance
Et lui donne un désir d’amour et d’indolence.
Troublé dans l’action, troublé dans le dessein,
Il rêvera partout à la chaleur du sein,
Aux chansons de la nuit, aux baisers de l’aurore,
À la lèvre de feu que sa lèvre dévore,
Aux cheveux dénoués qui roulent sur son front,
Et les regrets du lit, en marchant, le suivront.
Il ira dans la ville, et, là, les vierges folles
Le prendront dans leurs lacs aux premières paroles.
Plus fort il sera né, mieux il sera vaincu,
Car plus le fleuve est grand et plus il est ému.
Quand le combat que Dieu fit pour la créature
Et contre son semblable et contre la nature
Force l’Homme à chercher un sein où reposer,
Quand ses yeux sont en pleurs, il lui faut un baiser.
Mais il n’a pas encor fini toute sa tâche.
Vient un autre combat plus secret, traître et lâche ;
Sous son bras, sous son cœur se livre celui-là,
Et, plus ou moins, la Femme est toujours Dalila.
Elle rit et triomphe, en sa froideur savante,
Au milieu de ses sœurs elle attend et se vante
De ne rien éprouver des atteintes du feu.
À sa plus belle amie elle en a fait l’aveu :
« Elle se fait aimer sans aimer elle-même ;
« Un Maître lui fait peur. C’est le plaisir qu’elle aime,
« L’Homme est rude et le prend sans savoir le donner.
« Un sacrifice illustre et fait pour étonner
« Rehausse mieux que l’or, aux yeux de ses pareilles,
« La beauté qui produit tant d’étranges merveilles
« Et d’un sang précieux sait arroser ses pas. »
— Donc ce que j’ai voulu, Seigneur, n’existe pas ! —
Celle à qui va l’amour et de qui vient la vie,
Celle-là, par orgueil, se fait notre ennemie.
La Femme est, à présent, pire que dans ces temps
Où, voyant les humains, Dieu dit : « Je me repens ! »
Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
La Femme aura Gomorrhe et l’Homme aura Sodome ;
Et se jetant, de loin, un regard irrité,
Les deux sexes mourront chacun de son côté.
Éternel ! Dieu des forts ! vous savez que mon âme
N’avait pour aliment que l’amour d’une femme,
Puisant dans l’amour seul plus de sainte vigueur
Que mes cheveux divins n’en donnaient à mon cœur.
— Jugez-nous. — La voilà sur mes pieds endormie.
Trois fois elle a vendu mes secrets et ma vie,
Et trois fois a versé des pleurs fallacieux
Qui n’ont pu me cacher la rage de ses yeux ;
Honteuse qu’elle était, plus encor qu’étonnée,
De se voir découverte ensemble et pardonnée ;
Car la bonté de l’Homme est forte, et sa douceur
Écrase, en l’absolvant, l’être faible et menteur.
Mais enfin je suis las. J’ai l’âme si pesante,
Que mon corps gigantesque et ma tête puissante
Qui soutiennent le poids des colonnes d’airain
Ne la peuvent porter avec tout son chagrin.
Toujours voir serpenter la vipère dorée
Qui se traîne en sa fange et s’y croit ignorée ;
Toujours ce compagnon dont le cœur n’est pas sûr,
La Femme, enfant malade et douze fois impur !
Toujours mettre sa force à garder sa colère
Dans son cœur offensé, comme en un sanctuaire
D’où le feu s’échappant irait tout dévorer.
Interdire à ses yeux de voir ou de pleurer,
C’est trop ! Dieu, s’il le veut, peut balayer ma cendre.
J’ai donné mon secret, Dalila va le vendre.
Qu’ils seront beaux, les pieds de celui qui viendra
Pour m’annoncer la mort ! — Ce qui sera, sera ! »
Il dit et s’endormit près d’elle jusqu’à l’heure
Où les guerriers tremblants d’être dans sa demeure,
Payant au poids de l’or chacun de ses cheveux,
Attachèrent ses mains et brûlèrent ses yeux,
Le traînèrent sanglant et chargé d’une chaîne
Que douze grands taureaux ne tiraient qu’avec peine,
La placèrent debout, silencieusement,
Devant Dagon, leur Dieu, qui gémit sourdement
Et deux fois, en tournant, recula sur sa base
Et fit pâlir deux fois ses prêtres en extase ;
Allumèrent l’encens ; dressèrent un festin
Dont le bruit s’entendait du mont le plus lointain ;
Et près de la génisse aux pieds du Dieu tuée
Placèrent Dalila, pâle prostituée,
Couronnée, adorée et reine du repas,
Mais tremblante et disant : Il ne me verra pas !
–
Terre et ciel ! avez-vous tressailli d’allégresse
Lorsque vous avez vu la menteuse maîtresse
Suivie d’un œil hagard les yeux tachés de sang
Qui cherchaient le soleil d’un regard impuissant ?
Et quand enfin Samson, secouant les colonnes
Qui faisaient le soutien des immenses Pylônes,
Écrasa d’un seul coup, sous les débris mortels,
Ses trois mille ennemis, leurs dieux et leurs autels ?
Terre et Ciel ! punissez par de telles justices
La trahison ourdie en des amours factices,
Et la délation du secret de nos cœurs
Arraché dans nos bras par des baisers menteurs !
Écrit à Shavington (Angleterre), 7 avril 1839.
Alfred de Vigny, Les Destinées : poëmes philosophiques, 1864
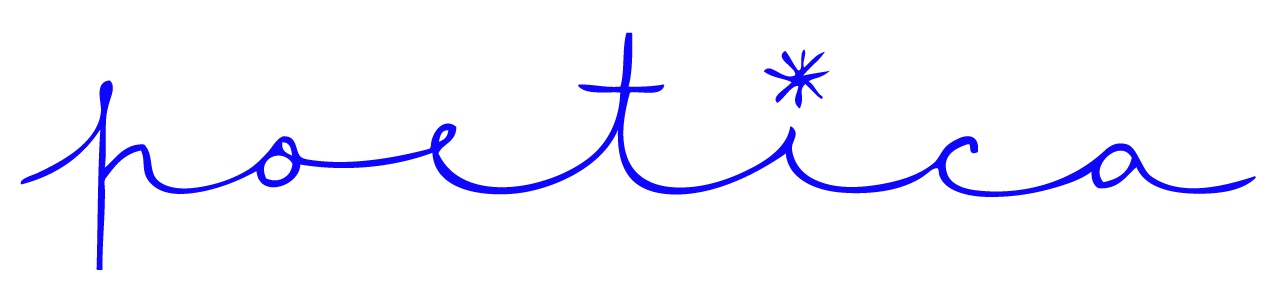

Purée, quelle force… quelle fulgurance… Et en même temps… quelle réalisme sur les femmes sans scrupule…
Magnifique, puissant, et désespéré.
Stupéfiant
Personne n’a aimé ? Je suis le seul commentaire? 🙁
Waw ! Enfin un poème qui me plait dans ce site !