Tu commences par me louer,
Tu veux finir par me connaître.
Tu me loueras bien moins ; mais il faut t’avouer
Ce que je suis, ce que je voudrais être.
J’aurai vu dans trois ans passer quarante hivers ;
Apollon présidait un jour qui m’a vu naître ;
Au sortir du berceau j’ai bégayé des vers ;
Bientôt ce dieu puissant m’ouvrit son sanctuaire ;
Mon cœur, vaincu par lui, se rangea sous sa loi.
D’autres ont fait des vers par le désir d’en faire ;
Je fus poète malgré moi.
Tous les goûts à la fois sont entrés dans mon âme ;
Tout art a mon hommage, et tout plaisir m’enflamme :
La peinture me charme ; on me voit quelquefois,
Au palais de Philippe, ou dans celui des rois,
Sous les efforts de l’art admirer la nature,
Du brillant Cagliari saisir l’esprit divin,
Et dévorer des yeux la touche noble et sûre
De Raphaël et du Poussin.
De ces appartements qu’anime la peinture
Sur les pas du plaisir je vole à l’opéra.
J’applaudis tout ce qui me touche,
La fertilité de Campra,
La gaîté de Mouret, les grâces de Destouches :
Pélissier par son art, le Maure par sa voix,
Tour à tour ont mes vœux et suspendent mon choix.
Quelquefois, embrassant la science hardie
Que la curiosité
Honora par vanité
Du nom de philosophie,
Je cours après Newton dans l’abyme des cieux ;
Je veux voir si des nuits la courrière inégale,
Par le pouvoir changeant d’une force centrale,
En gravitant vers nous s’approche de nos yeux,
Et pèse d’autant plus qu’elle est près de ces lieux
Dans les limites d’un ovale.
J’en entends raisonner les plus profonds esprits,
Maupertuis et Clairault, calculante cabale ;
Je les vois qui des cieux franchissent l’intervalle,
Et je vois trop souvent que j’ai très peu compris.
De ces obscurités je passe à la morale ;
Je lis au cœur de l’homme, et souvent j’en rougis ;
J’examine avec soin les informes écrits,
Les monuments épars, et le style énergique
De ce fameux Pascal, ce dévot satirique ;
Je vois ce rare esprit trop prompt à s’enflammer ;
Je combats ses rigueurs extrêmes :
Il enseigne aux humains à se haïr eux-mêmes ;
Je voudrais, malgré lui, leur apprendre à s’aimer.
Ainsi mes jours égaux, que les Muses remplissent,
Sans soins, sans passions, sans préjugés fâcheux,
Commencent avec joie, et vivement finissent
Par des soupers délicieux.
L’amour dans mes plaisirs ne mêle plus ses peines ;
La tardive raison vient de briser mes chaînes :
J’ai quitté prudemment ce dieu qui m’a quitté ;
J’ai passé l’heureux temps fait pour la volupté.
Est-il donc vrai, grands Dieux, il ne faut plus que j’aime ?
La foule des beaux arts, dont je veux tour à tour
Remplir le vide de moi-même,
N’est pas encore assez pour remplacer l’amour.
Voltaire, Épîtres, stances et odes
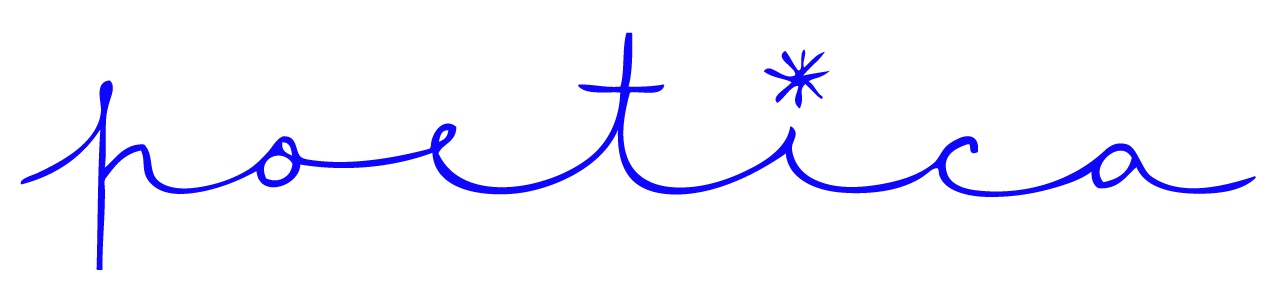

Je suis tombé par terre c la faute à Voltaire.
Sciences n’est que ruine l’âme es vrai? Tout ces poèmes écrits par ces gens ne touchent que l’âme des enfants. Pourri. Sans espoir. Poète. Pouette Pouette.
@ Jipehem. Merci, encore…
Grand Ciel, je vous rends grâce,
D’avoir lavé cette souillure
Mais l’accent de mon âme
Serait beaucoup plus fort
Si de ce même accent,
De ce même ornement,
Vous vouliez embellir,
Et encor, et encor,
La “gaîté” de Mouret,
Les “grâces” de Destouches.
@ Jipehem. C’est fait. Merci !
Oh, Ciel !
Effacez de ce texte une tache cruelle
Qui outrage le chant
D’une lyre si belle !
Tu me loueras, non me louras !
Et Voltaire sachant
Qu’on prend soin de lui
Paisiblement suivra
Son chemin dans la nuit.
j’adore voltaire !