Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
Or, chaque fois que je viens à l’entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C’est sous Louis treize ; et je crois voir s’étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,
Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que, dans une autre existence peut-être,
J’ai déjà vue… – et dont je me souviens !
Gérard de Nerval
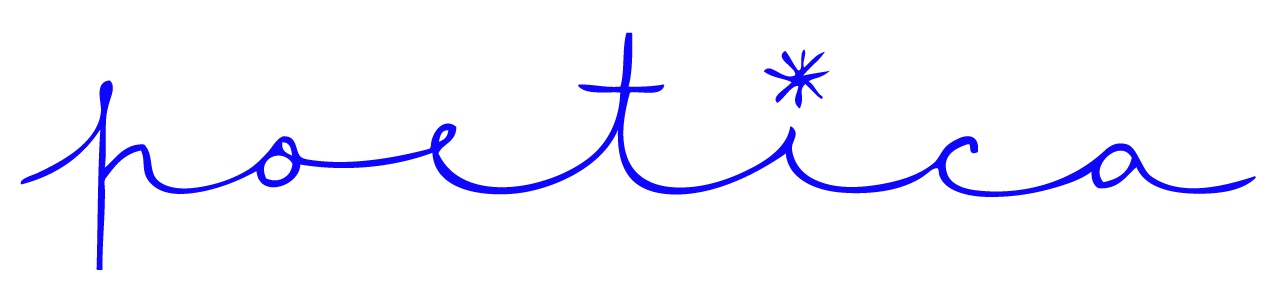

Pour finir j’aimerais m’attarder sur cet « air languissant et funèbre » déclencheur de toute la rêverie et donc du poème.
Quentin, le 24 octobre 2019 à 21h28, a retrouvé la chanson évoquée dans le poème et en a posté une belle interprétation dans le site « https://youtu.be/5NRbXmdnRoE ». Je l’ai écoutée attentivement.
Il s’agit de « la complainte de la fille au Roi Louis » à laquelle le saint roi refuse le mariage avec le chevalier Déon, qui est un félon.
La princesse préfère alors mourir que de quitter son amant…
Je retiens particulièrement cette strophe, la 4ème sur les 19 que comporte le chant :
« Avant que changer mes amours,
J’aime mieux mourir dans la tour.
— Eh bien ma fille, vous y mourrez,
De guérison point vous n’aurez. »
Finalement la princesse, enfermée sept ans « dans la tour » les fers aux pieds, mourra de mauvais traitements, puis sera « ressuscitée » pendant la procession funèbre par un baiser du chevalier qui se mariera ainsi avec elle le jour même de son enterrement !
Comme déjà analysé, on est bien en présence d’une complainte « funèbre » du Valois, remontant au XIIIème siècle (bien loin du XVIIème de Louis XIII et du « château de brique à coins de pierre »), qui parle d’amour et de mort…
Et, sans vouloir trop forcer le texte, je vois dans cet « air très vieux languissant et funèbre », l’évocation d’un thrène, paroxysme de la « complainte », lamentation funèbre chantée lors des funérailles : il y a dans cette remontée dans le temps de « deux cents ans » en arrière, et bien au-delà jusqu’au XIIIème siècle, quelque chose comme une plongée dans la mort au rythme du thrène, de la même manière qu’Orphée est descendu dans les Enfers accompagné du chant de sa lyre à la recherche d’Eurydice.
Cette « dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens », est-elle la mère que le poète perdit à l’âge de deux ans, ou déjà Aurélia qui inspirera son poème («Aurélia ou le rêve et la vie ») en 1855 à la fin de sa vie ?
Elle est en tout cas l’image d’une défunte à laquelle Nerval rêve les yeux ouverts et qu’il fait revivre par le poème, forme que prend chez lui le baiser chevaleresque… Il se « souvient » d’elle car il l’a déjà vue dans une vie antérieure, une vie qui a précédé son « existence » présente (l’enfance, l’adolescence ?), et cette image est la réminiscence d’une forme idéale visible seulement dans le ciel de la Poésie : Femme ou Poésie, Femme et Poésie, unique Réalité, auquel seul le rêve -grâce aux « charmes secrets » de « l’air très vieux languissant et funèbre »- nous permet d’accéder…
Et peut-être même que cette défunte « blonde aux yeux noirs en ses habits anciens » est, selon les mystérieuses lois du rêve et de son processus inconscient de « condensation » qui ignore tout de la logique humaine (principes d’identité, de non-contradiction et de causalité), au-delà de la mère défunte ou de l’amante perdue, l’image même de la Mort, de l’Amour et de la Mort intimement et brusquement unis indissociablement dans la vision du poète le bref instant d’un « éclair unique »…
(suite… et fin ?)
Il y a un aspect du poème qui présente un grand d’intérêt : c’est le rapport de Nerval au temps, magnifiquement illustré ici…
Quand j’ai parlé précédemment d’une « rupture » au début de la 2ème strophe, d’un « saut » dans une autre dimension doublement onirique et poétique qui se produit après le « 0r » à l’attaque du 5ème vers, il faudrait nuancer et préciser que ce saut n’est pas à pieds joints : Nerval garde un pied dans le temps présent de l’énonciation (« je crois voir », « je me souviens »), il n’appareille pas complètement vers un XVIIème siècle rêvé (« de deux-cents ans mon âme rajeunit), il n’y a pas « analepse » comme cela pourrait se produire dans un récit fantastique : il imagine un passé à partir de l’écoute présente de « l’air languissant », et ce passé rêvé, irréel, le « rajeunit », c’est un bain de jouvence dans lequel il puise son inspiration poétique comme à une source intarissable.
Ce passé vieux « de deux-cents ans », et qui cependant le « rajeunit », n’est pas « en arrière » mais (comme l’Orient qui aimantera aussi l’imaginaire du poète spatialement) « à côté », ou plutôt « en dessous », il est « l’autre » dimension du temps et de la personnalité du poète… ce qui lui permet de faire peau neuve presque instantanément, comme par magie, sous l’effet du « charme » musical (on pense à la sonate de Vinteuil chez Proust) et lui donne une raison de vivre.
Le rêve est chez Nerval une dimension du réel, peut-être même le « plus-que-réel » : le Réel avec un grand R.
Et l’on remarque à la fois une alternance de détails très précis (la date exacte -en effet si le poème a été composé en 1832, on est bien « sous Louis XIII » en 1632, deux cents ans auparavant-, le château de brique à coins de pierre, les vitraux rougeâtres etc.) et d’imprécisions que dénote l’emploi de modalisateurs : « je crois voir s’étendre », « dans une autre existence, peut-être », trahissant la prise de distance (et pour cause) du poète par rapport à ses « souvenirs »…
Et il y a de l’imprécision au cœur même de la précision : en lisant le poème on pense de manière très précise à Louis XIII bien sûr, mais aussi aux Valois (nom qui fait référence à la dynastie de la Renaissance mais aussi à la région du Valois si chère à Nerval) et encore plus avant, au XIIIème siècle du « fin’amor » : nous avons bien affaire ici à un « moyen-âge » mythifié totalement créé, recomposé par le poète qui ne correspond à aucune époque historique réelle mais semble dessiner les contours d’un paysage mental intérieur à la recherche éperdu d’un ailleurs…
Cette porosité entre les temps évoqués, cette interpénétration du présent et d’un passé « médiéval » très étendu, d’un passé rêvé à partir du présent et d’un présent vécu à travers les brumes d’un passé idéalisé, renvoie évidemment à la psychologie d’un poète ayant eu du mal à unifier sa personnalité, lui qui affirmait en plein crise d’identité : « Je suis l’autre », loin de l’unité transcendante du « Je » poétique affirmée avec force par Rimbaud plus tard : « Je est un autre »…
D’où cette évocation toute « naturelle » chez Nerval d’une « autre existence » en fin de poème à la vue de la Dame mystérieuse qui trône au centre de la « vision » et dans le cœur du poète, en laquelle probablement réside une des clés de l’énigme nervalienne : le poète pense quelque part sincèrement avoir déjà rencontré cette « blonde aux yeux noirs » dans une vie antérieure seule vraie, et à laquelle seul le rêve éveillé peut lui donner accès…
Nerval rêve ici, comme souvent, les yeux ouverts, il oscille sans cesse entre souvenir très précis (jusqu’au détail des murs « de brique à coins de pierre ») d’un monde parallèle inventé (ou retrouvé dans son essentialité ?) à partir d’une sensation ou d’un événement réel, et souvenir brouillé d’un visage, d’une scène ou d’un paysage comme aperçu à travers les brumes des sous-bois de la forêt d’Ermenonville au petit-matin, et d’ailleurs peut-être eût-il mieux valu pour lui qu’il fermât complètement les yeux et sautât à pieds joints dans le rêve -comme Verlaine dans « Mon rêve familier », par exemple, où les limites sont clairement définies- que de rester ainsi à roder à la lisière indéfinie de la clairière et des sous-bois, entre chien et loup, avant d’être emporté par le loup… mais on y aurait alors certainement perdu de pouvoir goûter aux plus belles pages, en tout cas parmi les plus chargées de mystère, de notre poésie de France…
(Suite) Le poème ne parcourt pas de distance, il ne va pas d’un point A à un point B comme le fait la prose, il n’est pas linéaire mais spiroïdal : il s’enfonce ou s’élève à la verticale de ses strophes (ou de ses paragraphes, lorsqu’il est en prose) et vrille autour d’un point fixe qui est son secret à la fois caché et révélé.
C’est ainsi que dans « Fantaisie », le poème ne va pas de « L’air très vieux languissant et funèbre » de la 1ère strophe, à la « Dame à sa haute fenêtre » de la dernière strophe, en passant par « Louis XIII », « les coteaux verts » et « le château de briques » etc. : il tourne dès le début et à chaque strophe autour de la « Dame » qui est figuration de « l’air très vieux languissant et funèbre ».
On peut lire le poème en partant de la fin : la Dame est dans le château qui est sur le coteau, « sous Louis XIII », le tout contenu dès le début dans « l’air languissant et funèbre » : comme pour les poupées gigognes la partie occupe pleinement le tout et le tout révèle déjà la partie…
Il n’y a pas succession mais simultanéité : le « puis » qui rythme le poème n’est pas vraiment temporel mais logique, il organise dans l’espace de la page la répartition de plans qui se lisent dans un même temps…
Le poème fonctionne comme un rêve (et l’on connaît l’importance de la dimension onirique chez Nerval) : il fonctionne par condensation, déplacement et figuration… Les images se mêlent, se (con)fondent, se superposent, se remplacent, surgissent l’une de l’autre comme dans la métaphore, ou se lient par contact comme dans la métonymie et a fortiori la synecdoque : tout le poème est à la fois métaphore et métonymie de « l’air très vieux languissant et funèbre » pour s’achever dans la figuration métaphorique de la Dame, suprême « vision » et « souvenir » vécu intensément…
Dès lors on peut s’étonner du « or » au début de la 2ème strophe, qui indique normalement une rupture et une opposition, alors que la suite du poème n’est précisément que le développement de ces « charmes secrets » de « l’air très vieux » : on s’attendrait à un « car » ou un « et »…
Mais il faut comprendre « charmes » (« carmina », pl. de « carmen ») au sens de « paroles magiques, enchantements » (Dict. latin-français Gaffiot) qui justement nous amènent dans un autre monde, une autre dimension.
« Charmes secrets » est donc une formule tautologique -le propre de toute formule magique incantatoire, qui procède par répétition- qui clôt la 1ère strophe et nous ouvre les portes de corne et d’ivoire du monde onirique et poétique…
« Or » marquerait donc une rupture entre la 1ère strophe, qui évoque l’écoute musicale de « l’air » dans le monde « naturel », et les autres strophes qui s’enfoncent dans le monde « surnaturel » de la pure vision, une rupture non « logique » donc (relevant de l’ordre du discours) mais bien « ontologique » (relevant de l’ordre de l’être), un saut d’un monde à l’autre…
Dès lors le poète aborde la dimension proprement poétique de l’œuvre, et s’il s’enfonce dans une quelconque « épaisseur » ce ne peut être que celle du langage (qui commande lui-même au fonctionnement du rêve)…
Comme nous le disions en commençant, le poète ne marche pas, il ne va pas d’un point A à un point B, il ne « court pas sur les quais de marbre » : ce sont ses mots magiques, ses « charmes », qui font mouvoir « les quais ». Le poète « lève les voiles en agitant les bras », il dé-voile ce centre mystérieux du Désir qui le meut, entraînant dans son sillage son lecteur attentif, éveillant, faisant poindre à l’horizon l’aube d’un nouveau monde, qui étrangement peut se confondre avec le souvenir revécu de l’ancien dans la vision d’une Aube éternelle : il approfondit sans cesse, jusqu’au vertige, « le secret douloureux qui le fait languir » qui n’est autre que le secret insondable et impalpable de la Vie et de son pathos !
Et tantôt ce secret prend le visage ou la forme (qui est image mémorielle fondamentale) de la Dame, de l’Ailleurs, de l’Eternité, de la Musique, de la Mer, de l’Amour etc. mais qui renvoie toujours quelque part à la forme essentielle de la Poésie autocélébrée où se profile, au cœur de la plus vive lumière, l’ombre de la Mort : la « Dame blonde aux yeux noirs », « le soleil noir de la mélancolie », les « deux trous rouges au côté droit », « l’inflexion des voix chères qui se sont tues »…
Au fond, comme j’ai essayé de le développer dans le commentaire de « La Vie antérieure » de Baudelaire (qui est une étude et une recherche), le sens profond d’un poème, et particulièrement d’un sonnet, apparaît dès le 1er vers : « l’air [de musique] », c’est déjà la « Dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs », et c’est toujours la Poésie qui apparaît pleinement aux yeux du poète (et du lecteur) en toute sa majesté et son mystère dans la dernière strophe au-delà de laquelle le poète ne peut plus rien voir (et c’est la fin du poème), c’est « L’aube et l’Enfant [qui] tombèrent au bas du bois »…
Le sens se révèle progressivement au cours du poème, il s’approfondit par plans successifs que rythme le connecteur logique « puis » à l’attaque des 3ème et 4ème strophes, mais il est déjà porté par « l’air [de musique] » dès le 1er vers…
Le poème progresse vers sa pleine lumière, il s’approfondit d’abord horizontalement et élève in fine son champ de vision (la Dame est « à sa haute fenêtre » : elle fait lever le regard), mais il n’y a pas évolution du sens proprement dit, seulement révélation progressive du sens, vers toujours plus de clarté et de verticalité…
Pour être plus explicite, et en référence à un autre célèbre poème étudié aussi dans le site de « Poetica », je dirais que le « Dormeur du val » est bien mort et saigne dès le premier vers, et de nombreux indices précis éparpillés dans les strophes nous le montrent : il ne meurt pas, il n’est pas tué pendant le poème, juste avant le dernier vers… et cependant le sens de la scène qui n’a rien de bucolique, comme une première lecture superficielle pourrait le laisser croire (ambiguïté savamment entretenue par le poète pour renforcer le scandale de cette mort), apparaît dans toute sa lumière et sa violence en fin de poème : le dernier vers (la chute dans un sonnet) correspond à l’état de conscience poétique le plus fort.
Mais dans le « Dormeur du val » la verticalité finale ne va pas vers le haut et la clarté apollinienne comme dans « Fantaisie », mais vers le bas et le royaume de Pluton, et la « lumière » devient alors sanglante et noire (on sait que le sang frais est noir), elle éclabousse définitivement tout le poème d’un sang poisseux que l’on ne peut plus effacer…
On pense à ces vers prémonitoires d’Apollinaire :
« Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier »…
(Suite) J’aurais pu évidemment citer aussi » Mon rêve familier » de Verlaine, autre grand poème de la réminiscence où la Poésie rayonne de sa mystérieuse présence magnétique toute féminine, comme une Maestà de Cimabué… et tant d’autres chefs-d’œuvre….
Je reviens vers ce si beau poème, déjà abordé le 17.04.24.
J’avais parlé d’un travail poétique de la Mémoire, mère des Muses, et d’une anamnèse grâce au médium de la Musique (art des Muses par excellence) qui rend progressivement présente au poète, et au lecteur devenu poète à sa suite, la « dame blonde aux yeux noirs » des romans de chevalerie, qui pourrait bien être la « Dame à la licorne », symbole de pureté…
Nulle sensualité en effet dans ce poème qui fait apparaître la Dame dans la dernière strophe, la rend visible à travers un Souvenir par définition impalpable : on pourrait parler de « matière spirituelle » au sens où certains théologiens, à la suite de St Augustin, donnaient un corps aux anges…
Dans ce poème, comme dans tout grand poème -et comme on l’a vu déjà dans « Aube » de Rimbaud, « Apparition » de Mallarmé ou « La Vie antérieure » de Baudelaire-, la Poésie se re-présente, se met en scène sans le déclarer, comme le Christ auprès des pèlerins d’Emmaüs qui n’ont perçu Sa présence qu’au travers d’un « réchauffement de leur cœur ».
Au fur et à mesure de l’avancée du poème les plans se succèdent, s’approfondissent (sous Louis XIII, le coteau vert, le château de briques), s’éclaircissent, pour se concentrer dans l’ultime strophe sur la « Dame blonde aux yeux noirs » dans une sorte de « gros plan » final évanescent, une pure « apparition », un pur Souvenir et Souvenir pur, « amour réalisé d’un désir demeuré désir »…
La Poésie est là, elle rayonne en majesté dans sa plus haute tour, et notre cœur brûle…
La Poésie est donc présente à deux niveaux dans ce poème, d’où sa force évocatrice, sa clarté toute spirituelle : d’abord dans la musique de la 1ère strophe (« Il est un air »), et dans la « dame blonde aux yeux noirs » de la dernière strophe ensuite, incarnation spirituelle finale et progressive de la Musique… et entre les deux s’est déroulé tout le travail d’approfondissement de la conscience poétique qui procède par étapes vers toujours plus de clarté, et renvoie toujours à un « Souvenir » premier et fondateur, celui de l’autre Temps, celui de la vraie Vie si souvent « absente », car nous sommes si peu « au monde »….
C’est un poème que j’ai appris en 1969, en classe de 3eme au lycée Amirouche de Tizi Oueou avec le prof de français, M. Monieze.
Très beau poème facile à apprendre
Très beau poème facile à apprendre.
Très beau poème
J’avais 12ans, mon instit Yvan L. nous l’a imposé. Ce fut mon éveil à la poésie, puis à la littérature française. Un très grand merci.
Il y en a qui devais l’apprendre en 1974 et nous en 2024 on doit apprendre ça au collège c’est une honte !
Ce poème en décasyllabe avec son mètre musical en 4/10 a tout le charme discret de l’élégie : l’évocation nostalgique du temps passé.
Mais ici le registre élégiaque, forme de lyrisme, n’évoque pas seulement un temps révolu : le poème, qui se veut la stricte reprise en vers de l’air entendu, réactive à chaque audition de cet « air », le souvenir de cette « dame blonde aux yeux noirs » déjà vue dans une autre existence (« peut-être ») et à nouveau ici présente au poète avec toute la force d’une anamnèse : on peut parler de « présence réelle » !
D’où le passage d’un présent de vérité générale (« Il est un air ») ou d’habitude (« à chaque fois que je viens à l’entendre ») au présent d’énonciation final ( » – et dont je me souviens ! »), qui suit et s’oppose à un ultime passé composé (« que j’ai déjà vue »), dans un « temps retrouvé » in fine que confirme la ponctuation expressive du point d’exclamation sur lequel s’achève le poème et qui sonne comme une victoire sur le temps : « l’air languissant et funèbre » du début a parfaitement opéré et accompli , via le poème qui est son médium et en quelque sorte son décalque (sa « mimesis » dirait Aristote), sa mission sacramentale de « mise en présence »…
Toute la poésie de Nerval est là, dans cette dimension onirique qui déborde et contamine le temps de l’état de veille à l’occasion d’un élément déclencheur (ici « l’air de musique ») pour nous projeter dans un autre temps qui est celui de la vraie vie : celui du souvenir revécu, le « temps retrouvé », dirait Proust.
Le moment du poème est ici celui du « couchant », moment justement où le veilleur va s’enfoncer dans le sommeil et commence déjà à franchir le seuil poreux des portes d’ivoire et de corne.
Cette dame est la Dame des romans de chevalerie, elle est la muse qui aimante le regard du poète courtois et donne tout son sens à sa vie.
Au-delà de Louis XIII et de ses châteaux en « briques à coins de pierre », on pense aux Valois, à Henri II, ou encore au-delà, au XIIIème siècle et à son culte de l’amour courtois avec la noble Dame recluse en son donjon… mais qu’importe l’époque : le temps est aboli ici dans « l’air » re-présenté (i.e. rendu présent à nouveau) par le poème qui actualise la vision poétique !
On pense aussi à cette « femme inconnue » de Verlaine, elle aussi aperçue dans un rêve (familier au poète) où l’on peut voir l’une des sources intarissables de l’inspiration poétique atteinte en son essence…
Regardez les photos du Château Pastré à Marseille… La comtesse Lily Pastré est à l origine du Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence qui fête ses 75 ans. Elle avait caché des musiciens juifs pendant la guerre.
Je trouve que ce poème est très charmant et très facile à apprendre. C’est pour ça que je l’aime bien.
Complainte médiévale « La fille du Roy Louis »
Paroles ci-dessous
Le Roi Louis est sur son pont
Tenant sa fille en son giron
Elle se voudrait bien marier
Au beau Déon, franc chevalier
Ma fille, n’aimez jamais Déon
Car c’est un chevalier félon;
C’est le plus pauvre chevalier,
Qui n’a pas vaillant six deniers.
-J’aime Déon, je l’aimerai,
J’aime Déon pour sa beauté,
Plus que ma mère et mes parents,
Et vous mon père, qui m’aimez tant.
-Ma fille, il faut changer d’amour,
Ou vous entrerez dans la tour.
-J’aime mieux rester dans la tour,
Mon père que de changer d’amour.
-Avant que changer mes amours,
J’aime mieux mourir dans la tour.
-Eh bien ma fille, vous y mourrez,
De guérison point vous n’aurez.
Le beau Déon, passant par-là,
Un mot de lettre lui jeta;
Il y avait dessus écrit:
« Belle, ne le mettez en oubli »;
Faites-vous morte ensevelir,
Que l’on vous porte à Saint-Denis;
En terre laissez-vous porter,
Point enterrer ne vous lairrai
La belle n’y a pas manqué,
Dans le moment a trépassé;
Elle s’est laissé ensevelir,
On l’a portée à Saint-Denis.
Le roi va derrière en pleurant,
Les prêtres vont devant chantant:
Quatre-vingts prêtres, trente abbés,
Autant d’évêques couronnés.
Le beau Déon passant par-là:
-Arrêtez, prêtres, halte-là!
C’est m’amie que vous emportez,
Ah! Laissez-moi la regarder!
Il tira son couteau d’or fin
Et décousit le drap de lin:
En l’embrassant, fit un soupir,
La belle lui fit un sourire
-Ah! Voyez quelle trahison
De ma fille et du beau Déon!
Il les faut pourtant marier,
Et qu’il n’en soit jamais parlé.
Sonnez trompettes et violons,
Ma fille aura le beau Déon.
Fillette qu’a envie d’aimer,
Père ne peut l’en empêcher !
j’ai connu des étrangers, et surtout des étrangères, qui sont tombés amoureux de la langue française et de la France après avoir écouté la « Fantaisie » de Gérard de Nerval. La musicalité, le rythme du texte sont si envoûtants que l’on reste sous le charme des années durant lorsqu’on l’a entendu lire la première fois. La tombe de Nerval , élégante et discrète, à son image, mérite d’être visitée au cimetière du Père Lachaise.
C’est très beau
✨Trop cool ✨
C étrange comme texte mais sinon c bien.
J’ai eu à apprendre ce poéme, grâce à mon professeur de français, un métropolitain , Monsieur Oliel. C’était en 1974, au lycée Michelet de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Même sous les tropiques de mon île merveilleuse, il a raisonné dans mon imaginaire afro-caribéen, et est resté gravé dans ma mémoire. 47 ans plus tard, sa musicalité étrange, rythmée, sa perspective immense, enchantent mes amis…métropolitains pour qui je le déclame, et qui, souvent le découvre ainsi. « Donnes, encore, je recevrai pour transmettre »
Poème de fin de la symphonie historique du château de Bidache où j’étais figurante comme Paul ! Je me rappelle chaque vers… Et je vois encore Corisande d’Andoins seule en haut du château ! Que de souvenirs !
Il est un air qui me restera toujours dans la tête ! J’ai adoré la plume de Gérard de Nerval.
J’ai découvert ce poème lors du spectacle son et lumière « La symphonie Historique du Château de Bidache ». J’avais 12 ans et j’y jouais comme figurant. Il était récité sur le Prélude de Tristan et Yseult de Wagner. Je l’ai toujours en mémoire 40 ans plus tard. Je ne connaissais pas son auteur, merci.
Je trouve se poème sympa mais j’ai appris ce poème en 5eme et je le trouve toujours dur à apprendre et cela m’enerve fortement je trouve inutile d’apprendre ce genre de chose si c’est pour l’oublier après mais certains disent que c’est pour faire travailler la mémoire… Je ne trouve pas
Si joli, si doux et berçant cet air… Ce texte est prenant, tranquilisé avec une pointe de tristesse et rempli d’émotion !
Je vous conseille d’écouter cette lecture qui rend encore plus le texte merveilleux (qu’il est déjà) :
https://youtu.be/h0-5oLtHzVg
Qui donc me chuchote à l’oreille, que d’un autre temps l’on m’appelle? Qui donc me dit tout bas, qu’en un autre temps l’on m’attend ?
Beau et spécial comme poème
Quentin, d’où tenez-vous cette information ? Acceptez mes remerciements les pus vifs.
Une pure merveille !!! Je l’ai appris en CE1 et aujourd’ hui, 51 ans plus tard, je m’en souviens comme si c’était hier.
Merci Quentin pour « La fille du Roy Louis » !
C’est un magnifique poème. Je suis en 5ème et je dois l’apprendre. Il est dur mais agréable. Je suis content de l’apprendre.
Nos êtres chers, va-t-on les retrouver ?
La vie c’est bien…
Moi, il me reste totalement pour cette prononciation de Wèbre, et j’ai toujours cru que cela se prononçait comme ça mais, là, à 57 balais je découvre que pas du tout, cela se prononce bel et bien WEBER…
Déception! Nerval avait seulement du mal à trouver une rime. On lui pardonne. Le poème que je redécouvre est vraiment un bijou.
À la vue des commentaires on dirait que beaucoup de gens ayant appris le poème étant petits ont été marqués et reviennent ici pour le lire. Pour compléter la beauté de l’œuvre, peut-être aimeriez-vous savoir de quel air parle Nerval ? Il s’agit de la complainte médiévale « La fille du Roy Louis » interprétée superbement ici par exemple https://youtu.be/5NRbXmdnRoE
On peut comprendre que l’auteur ne lui trouve pas d’égal ! Bonne continuation.
Ce poème m’a dérangé au plus haut point. Je l’ai détesté. Très ennuyant.
Bizarre que là on donne à apprendre ce poème en classe primaire…? Moi je l’avais dans ma liste du bac de français et c’est celui que j’ai tiré. J’ai eu une bonne note. Primaire… terminale? Je ne comprends pas et pour moi c’est un texte qui ne va pas en CE2 et encore moins en maternelle. Je pense même que certains intervenants des commentaires se trompent… de classe… ou de poème!
Très beau poème, que j’ai appris à l’école maternelle. Je me rappelle avec jouissance du 20/20 que ma chère maîtresse m’a déposé sur mon pupitre. Ces lettres sont gravées d’or et d’argent dans mon esprit, et à jamais, je me souviendrai de ce chef d’oeuvre de la langue de Zep.
Je l’ai appris quand j’étais en CE2, par choix : il fallait trouver un poème et l’apprendre. Il m’a tout de suite marqué. En cm2 je l’ai réappris, et cette année, en 5ème,j e l’ai retrouvé et il m’aide à vaincre la peur : je le récite en marchant; je pense que ce poème est une formule magique pour moi. Il est beau, touchant et mélancolique. Je n’ai jamais trouvé de poème qui me fasse le même effet à ce jour. Je le considère comme le plus beau poème du monde, mais chacun ses gouts !
C’est dur à apprendre mais une fois qu’on l’a appris elle reste dans la tête
Je ne sais pourquoi ce poème me revient sans cesse en mémoire et me poursuit. Je l’ai appris en secondaire et c’est sans nul doute, ce qui m’a poussée à entreprendre des études en philologie romane (Lettres chez vous), par la suite et à devenir modestement écrivain. « Qui pour moi seul(e) a des charmes secrets », rien que ce vers suffit à m’émouvoir et à me transporter dans un autre monde, tout comme Évariste Galois, dans le domaine des mathématiques et qui comme Nerval a trouvé une fin funeste, l’un, lors d’un duel, l’autre, s’étant pendu ! Peut-être que ces deux talents réunis, cueillis à la fleur de l’âge, ont déterminé mes choix de vie ! Allez savoir ?
J‘avais une discussion concernant le rythme de ce poême avec mon professeur dans une école allemande: il l’a recité 4/4, taTAtaTAtaTAtaTAtaTA – avec l‘effet inévitable que languissant devenait langUIssant et des charmes secrèts changeaient en charmEs secrèts. Finalement, au château de briques, les coins de pierre sont cassés totalement… Quand j‘ai lu le poême à lui comme valse, 3/4, tout allait rond, comme une pièce de musique. Mon professeur n‘hésitait pas de concéder qu’il s‘était trompé. Moi, ayant raison, me sentais mal.
Beau mélancolique
Je suis en CE2 et je l’apprends. Ce n’est pas facile.
Quand j’étais en 5éme ma prof de français me l’a donné à apprendre il y a de cela 4 ans. C’est l’un de mes préférés avec « heureux, qui comme Ulysse, a fait un bon voyage »
Cette poésie, je l’ai apprise au début des années 60, en 6e, au collège de Liévin, pour participer à un concours de diction. Si toute la classe m’avait choisie pour la représenter, ma professeure de Français a préféré une autre élève, Evelyne, perdue de vue et retrouvée avec joie quelques années plus tard, en seconde. Cette institutrice, alors que j’étais une bonne élève, ne m’aimait pas et cherchait à m’humilier : un jour, alors que j’étais sur l’estrade en train de réciter face à toute la classe, elle a soulevé légèrement ma jupe pour montrer mon jupon en s’écriant « a-t-on besoin d’un jupon en dentelle pour venir en classe » ? Aujourd’hui, ce genre de comportement porte un nom… J’ai oublié le nom de cette prof mais jamais cette poésie qui m’a sans doute donné l’envie d’en écrire beaucoup d’autres…
Je ne l’ai pas compris
Il y a des choses qui nous marquent à jamais… ce poème m’a bouleversée, alors que j’avais 13 ou 14 ans… par son rythme, une magnifique mélopée, son style et surtout son thème, les vies antérieures… J’aurai 60 ans dans quelques jours, et ce poème, comme beaucoup d’autres, a bercé mes moments d’evasion…. pour en citer d’autres: L’Automne de Lamartine, Spleen, Chant d’Automne, La chevelure, L’invitation au Voyage de Baudelaire, Demain dès L’aube de V.Hugo… Merci à mes professeurs de Français, qui ont su me communiquer leur passion pour les vers, et la belle prose…
C’est un poème que j’ai appris au lycée, il y a bien longtemps. J’ai aussitôt été séduit par sa beauté et son tempo mélancolique. Depuis, il ne m’a jamais quitté, il est souvent dans ma tête et il m’arrive parfois de le dire à des amis. J’adore sa musique langoureuse, celle d’un temps rêvé. Une merveille.
Ce très beau poème, je l’ai découvert, il y a peu. Je l’ai tellement aimé que j’ai pris la peine de le mémoriser ! A 72 ans, quitte à faire travailler ses neurones, autant le faire en beauté !
Je devais avoir 14 ans à l’époque ou j’ai appris ce poème, je ne l’ai jamais oublié. Quel bonheur de savoir que d’autres personnes partagent les mêmes souvenirs.
Mon fils avait appris ce poème en CM1 il y a environ 40 ans. Je ne l’ai jamais oublié. Quant à lui, je ne sais pas… « La Dame à la haute fenêtre » évoque pour moi un autre tableau du Moyen Age (donc antérieur) représentant une Dame assise devant une cheminée et lisant. Un jeune page se tient derrière son siège. Qui connait cela (peut-être une tapisserie du M-A) ?
Magnifique poème joyau de la langue francaise
Philippe, Gérard, oui il est nécessaire de se frotter à l’art, à la culture, pour nourrir notre esprit et notre coeur, et se donner la possibilité de s’élever. Ce poème de Nerval est un bijou et il transporte notre âme vagabonde vers des endroits inconnus de notre jardin secret.
Il y a plus de 50 ans, notre professeur de Français nous avait fait étudier ce poème. Aujourd’hui encore je m’en souviens et éprouve toujours autant de plaisir à y penser car cela me fait rêver et permet à chacun d’interpréter le décor, les personnages et l’atmosphère musical… un petit film! Merci M. de Nerval pour tant de sensibilité et de beauté
Voyez vous Philippe, il m’est agréable de constater que nous puissions, au travers de ce site, nous retrouver, malgré notre différence d’âge sur ce qui grandit l’être humain, son instruction. Merci à nos professeurs pour ce travail. Ils sont, à part conséquente, les artisans de notre savoir, de notre construction. L »écriture, la poésie, la musique, la culture dans son ensemble ne peuvent qu’élever le commun des mortels que nous sommes.
Gérard, moi, j’étais en seconde, au Lycée Français de Londres, mais il y a plutôt 60 ans (même un peu plus !). Moi aussi, ce texte ne m’a jamais quitté, je me le suis récité au moins une fois tous les ans, et moi aussi, je me rappelle mon professeur et sa remarque sur la rime « Webre » ! Un petit coup de jeune, merci ! Et quel merveilleux texte ! Philippe (77, ans !)
Un poème appris au collège en 5ème. 43 ans plus tard je l’ai toujours en mémoire et suis toujours en capacité de le réciter sans faute. J’ignore pourquoi il m’a tant gravé l’esprit. Je n’ai pas oublié également la remarque du professeur sur la rime de Weber que l’on doit prononcer Webre.
Magnifique poème , que je découvre à l’instant , sublime
On a vraiment l’impression de voir s’envoler les mots c’est sublime !
des mots légers comme la part des anges ,une inégalable mélancolie;un petit bijou taillé dans dans un diamant de nuage
Tres beau poeme.