J’ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.
Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d’une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.
C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs,
Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l’unique soin était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal
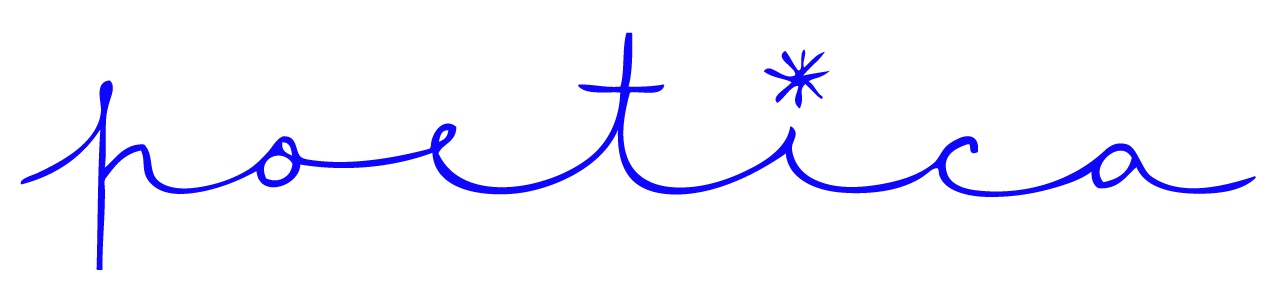

« La poésie est ce qu’il y a de plus réel : c’est ce qui n’est complètement vrai que dans un autre monde », écrit ailleurs Baudelaire.
Alors comment ne pas lire dans « La Vie antérieure » l’illustration même de ce qu’est la Poésie ?
Mais cet « autre monde » n’est pas avant ou après la vie, il n’est pas l’au-delà chrétien d’après la mort ou l’en-deçà platonicien d’avant la réincarnation des âmes : il est la Vie, la vraie vie redevenue présente à elle-même grâce au philtre poétique qui nous permet d’y accéder aussitôt, hic et nunc…
La poésie joue ici le rôle de l’espérance chrétienne, vertu théologale, ou de la réminiscence platonicienne qui me permettent de me remettre au bon niveau de lecture du réel, de prendre de la hauteur ou de la profondeur dès ici-bas…
La « vie antérieure » n’est donc pas « avant », mais « au-dessus » ou plus exactement « au-dessous », elle est une vie « intérieure » ou plutôt « inférieure », une vie parallèle à notre monde, qui se situe sur l’axe de la verticalité et non de la plate horizontalité chronologique : la vie antérieure se situe dans un autre temps, qui est le vrai temps, comme ces sources souterraines secrètes qui courent sous nos pieds incognito et sourdent brusquement de la terre pour jaillir en fraiches fontaines qui nous amènent la vraie joie…
C’est pourquoi le poète qui est un sourcier peut grâce à l’œuvre poétique qui est son pendule retrouver la source de vie et nous faire goûter à l’ambroisie, nous hausser ou nous plonger au niveau de la vraie Vie l’espace d’un poème qui va durer pour nous l’éternité…
Et ce passage d’un espace-temps à un autre est rendu possible ici dans le poème au moyen, entre autres, de deux procédés littéraires précis : la valeur des temps et le schéma rimique.
Le poème est entièrement au passé composé et à l’imparfait. Le passé composé (deux occurrences) indique une action accomplie. L’imparfait, principalement utilisé (six occurrences), est le temps de la description : la tonalité du poème est nettement contemplative, il s’agit d’un tableau qui retranscrit une vision, avec en arrière-fond un monde à la fois marin et oriental à l’instant du couchant, un univers exotique dirait-on, au rythme de vie ralenti comme celui des fonds marins, sur lequel se détache in fine le « vécu » à la fois « langoureux » et «douloureux » du poète-roi malheureux…
Mais le passé composé signifie-t-il seulement l’antériorité d’une action définitivement accomplie dont le poète a gardé la simple « mémoire » ? Le poète de toute évidence réactive la vision au moment où il parle et nous la fait partager : j’analyse ce passé composé, appuyé sur la toile de fond de l’imparfait descriptif, comme le procédé qui permet au poète de se projeter immédiatement dans un autre temps parallèle, celui de « l’autre monde » qu’il revit en plénitude, de parler d’un passé qui se poursuit au présent ; cette « mémoire » est un « souvenir » et même une « anamnèse » : oui, le poète habite toujours sous de vastes portiques et oui, il vit toujours dans les voluptés calmes au moment où il écrit… l’artifice littéraire du passé composé permet de faire le pont, dans l’instant de la page et de la composition poétique, entre les deux dimensions parallèles, et non successives, du temps (celui du triste quotidien de l’écriture et celui, illuminé, de « la vie antérieure »).
Le « C’est là » victorieux à l’attaque du premier tercet (v. 9), unique occurrence du présent lié au déictique « là », embraye clairement le discours sur le temps de l’énonciation dans une longue phrase unique qui s’étale sur les deux tercets : nous sommes bien dans le présent d’une vision réactivée dans et par l’écriture poétique…
Evidemment cette projection hors de l’ici-bas nécessite un lieu secret, un laboratoire naturel privilégié pour rentrer en contact avec l’au-delà : la profondeur chtonienne d’une « grotte basaltique» dans laquelle le poème s’enfonce dès la fin de la première strophe après avoir quitté les « vastes portiques » aériens du premier vers avec « leurs grands piliers droits et majestueux» qui s’enfoncent dans le sol, « grotte » qui n’est autre que la métaphore du poème, cet athanor au sein duquel peut s’opérer le franchissement des limites au moment très précis et mystérieux, entre tous, du crépuscule : l’instant de l’œuvre au rouge ?
L’autre procédé littéraire utilisé pour marquer ce passage magique, ce saut du temps du quotidien de l’écriture au temps de la vraie vie et de « l’autre monde », est le schéma rimique retenu. Et ici je vais m’appuyer sur l’analyse très intéressante faite par Jean-Louis Joubert dans son étude sur « La Poésie » chez Armand Colin (collection « Cursus », 1988, dont je ne peux que conseiller la lecture), sans en retenir la conclusion.
Pp. 135-136 : « Première irrégularité : les rimes des quatrains sont inversées : abba/baab. Pour souligner la correspondance et les échanges qui s’instaurent entre le ciel et la mer ? Seconde irrégularité : le schéma rimique des tercets est du type cdd/cee. Cette disposition brise la clôture du sonnet […]. Or le distique sur le plan sémantique, vient ruiner le bonheur paradisiaque qui s’étalait dans les trois quatrains. C’est le système des rimes, que tente de masquer l’artifice typographique de la présentation en tercets, qui porte le sens du poème : faux sonnet, et faux paradis… ».
Je retiens la riche analyse du système rimique, mais pour conclure dans un sens diamétralement opposé.
Le « secret douloureux » n’est pas simple souffrance négative : il est le pathos de la vie, la « passion » dans tous les sens du terme qui nous anime à chaque instant, le désir qui ne nous quitte jamais, objet à la fois, et dans un même temps, de joie et de douleur, tension permanente qui nous arrache à nous-mêmes, auto-affectation de la vie (comme dirait Michel Henry) qui se nourrit d’elle-même et devrait pouvoir se passer de tout autre objet de fixation, souffrir étant la seule modalité d’acquérir la sensation d’exister…
Que le poète ait pu « languir » de ce désir « douloureux » qu’il se souvient avoir ressenti à chaque instant au plus profond de lui-même dans cette « vie antérieure », prouve qu’il a atteint là à la vraie vie, à « l’autre monde » qui n’est autre que celui que nous ouvre la Poésie « amour réalisé d’un désir demeuré désir », amour passion, amour douleur et joie dans un même et unique temps…
Cette « vie antérieure » n’est pas le paradis chrétien éthéré : elle est la quintessence de la vie d’ici-bas, notre vie moins tout ce qui la surcharge inutilement (c’est-à-dire à peu près tout), elle cultive « l’unique nécessaire » dans ce désir essentiel et « douloureux » qui ne nous quitte pas et que l’on oublie pourtant sans cesse dans la recherche effrénée des objets du désir, lâchant la proie pour l’ombre…
En changeant la disposition rimique traditionnelle du sonnet, en l’inversant dans les quatrains (dans une formule « en miroir » en quelque sorte) et surtout le sizain (qui prend la forme d’un quatrain suivi d’un distique), Baudelaire remonte le temps, désenclenche les automatismes, les réflexes conditionnés, rompt le charme toxique de notre temps agité et amnésique, le dépasse, lui ôte son côté impérieux pour lui rendre sa « langueur », sa lenteur, sa densité, en un mot : sa durée essentielle…
Le distique final « [ne] ruine [pas] le bonheur paradisiaque qui s’étalait dans les trois quatrains» (et d’ailleurs, où Baudelaire parle-t-il d’un « paradis » et d’un « bonheur » ?) : il lui donne au contraire son vrai poids, son épaisseur, l’incarne, en montre toute l’ambivalence, exprime tout le pathos qui saisit l’homme à chaque fois qu’il veut être, ou se souvient avoir voulu être, à chaque fois qu’il pense et se souvient qu’il existe : « To be or not to be ».
Je m’étonne d’ailleurs pour finir de cette erreur de lecture, que j’ai constatée ailleurs, qui voudrait voir une évolution dans le sens du poème au fur et à mesure de l’écoulement des vers : un sonnet (court poème à forme fixe) ne se lit pas diachroniquement mais synchroniquement, il est un tout et la solidité de son sens repose, comme une pyramide, sur sa base, qui est la chute du poème ; ainsi il n’y a pas un bonheur premier qui serait « ruiné » ensuite par le distique final du « secret douloureux », mais un « secret douloureux » qui est présent dès le premier vers et qui, à la lecture du dernier vers, rejaillit rétroactivement en pleine lumière sur l’ensemble du poème, comme le sang du « Dormeur du val » ensanglante l’ensemble du poème à jamais dès que l’on en découvre la chute qui agit comme une révélation tragique et définitive…
Comme pour la compréhension de la vie, il y a deux temps à la lecture d’un sonnet : une première lecture innocente et naïve, celle de la découverte de l’enfance qui ne voit pas ou refuse de voir les « indices » pourtant bien présents, et une seconde lecture déflorée et initiée, une lecture adulte qui connaît le « secret » du sens de l’œuvre (de la vie) et ne l’oublie jamais plus !
Ce « secret douloureux » qui hante le poème depuis le début au travers de « signes » qu’il faut savoir lire et se révèle au grand jour dans le dernier vers, à la fin d’une première lecture, saute aux yeux dès le premier vers à la deuxième lecture : dans « les houles », « les tout-puissants accords de leur riche musique », dans les « couleurs du couchant » et « les voluptés calmes », « au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs », dans toute cette solennité grave dont est empreint le texte, cette ample majesté des « piliers », ces « mille feux » et cette rougeur du couchant, cette richesse capiteuse de la musique et des parfums, ce lourd calme de la volupté, cette lenteur du mouvement des « palmes » agitées par les esclaves, tous éléments chargés évidemment du poids du « secret douloureux» qui ralentit le rythme du texte : le « secret » est bien partout, dans chaque mot, chaque vers, il impose sa tonalité au poème qui n’est pas celle d’une joie paradisiaque qui aurait mal tourné soudainement, d’une joie subitement déçue qui ne s’est de fait jamais « étalée » (pas plus que le « sommeil » du « Dormeur du val » dans la verte nature), mais bien celle d’une conscience qui mûrit longuement (« J’ai longtemps habité ») et douloureusement son sentiment d’exister…
Faux sonnet et vrai travail de la conscience…
A noter cependant que dans cette façon qu’a toute grande œuvre de tourner autour d’un centre indicible, comme nous le disions précédemment, il y a symboliquement l’expression d’une fusion avec ce centre, comme le derviche tourneur tourne, jusqu’au vertige, autour de son propre centre en lequel se trouve son Seigneur (« interior intimo ejus »), ou encore comme le prêtre officiant tourne autour de l’autel pour le purifier au début de la messe ou lors de l’encensement à l’Offertoire, ou bien comme l’évêque dans le rite de consécration tourne autour de l’église, ou encore comme dans le rite du tawaf (circumambulation) où les pèlerins tournent autour de la Kaaba pour s’unir à elle lors du pèlerinage etc.
On peut dire, mutatis mutandis, que le poète, qui au fond n’écrit jamais qu’un seul poème, atteint ce centre poème après poème, dans et par l’écriture même de toute son œuvre : le sens profond du poème se découvre alors pour le lecteur que nous sommes de manière dynamique, par la répétition de la lecture de l’ensemble, ou du moins de plusieurs des poèmes, comme la répétition d’un mantra ou d’une litanie, et ainsi le poème est à la fois création et action dans l’élaboration d’un sens progressif toujours « en acte » qui ne se découvre que par sa psalmodie incessante mêlée à notre souffle…
Ainsi pour Baudelaire ici, où le poème sous-tend, alimente et satisfait son désir inextinguible d' »ailleurs », d’une « vie antérieure » qui est une « vie intérieure », et n’est autre que l’expression d’un désir de plénitude enfin retrouvée et réalisée au travers et au moyen du vide toujours en tension et toujours évanescent de la parole poétique toujours à recommencer…
Encore une fois l’écriture poétique n’est pas référentielle : elle ne décrit ici aucune île réelle, mais met tout simplement en scène le « désir » poétique.
« Le secret douloureux qui [le] faisait languir » n’est autre que ce désir d’être, cette transcendance, cet « autre monde » plus vrai que ce monde-ci qui tournente sans relâche le poète et qui est au cœur, qui est le moteur (comme le ciel des fixes meut l’univers) de toute la poétique baudelairienne.
Ce « secret douloureux » n’est autre que ce poème-ci indéfiniment répété sous différentes formes et qui est le centre mystérieux, jamais pleinement atteint, autour duquel tourne tout l’univers baudelairien : un grand poète n’écrit jamais qu’un seul poème polymorphe…
En quoi Baudelaire ne saurait être un poète romantique : c’est l’être qui le tourmente consciemment, et non les « états d’âme » diffus et confus ressentis par son moi au contact de la Nature… d’où la profondeur d’une poésie (comme celle de Nerval) qui va tracer son chemin unique sur la crête étroite et vertigineuse qui s’élève au-dessus des deux versants du Romantisme et du Parnasse, et que suivront, hardis, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (que l’on classera comme Symbolistes), sans oublier Valéry le disciple bien aimé de Mallarmé.
« La Poésie est l’amour réalisé d’un désir demeuré désir », dira René Char…
Delahaye :
Baudelaire homosexuel, lui le grand chantre du lesbianisme ?
Pourquoi pas ? Il l’a fait croire en tout cas, et il s’est même vanté d’être cru de certains, mais où sont les preuves ?
Ici ?
Et si tout simplement les sévères règles d’écriture du « e caduc » lui avaient interdit de mettre « esclaves » au féminin : « …des esclaves nues, tout imprégnées d’odeurs… » est doublement impossible : le « e caduc » ne peut se trouver à la fois après une voyelle (qui empêche de le lire depuis Malherbe, contrairement à ce qui se faisait au moyen-âge ou encore avec La Pléiade : »Mari-e levez-vous ; vous êtes paresseuse » écrit Ronsard) et devant une consonne (qui oblige à le lire) !
Baudelaire « homo » ? Je pense tout simplement « dandy »…
Les esclaves nus sont des hommes, dont l’unique soin était d’approfondir le secret douloureux qui me faisait languir, c’est à dire son homosexualité.
Ce type là ne boit pas que de l’eau !…
Commence comme dans un rêve harmonieux pour finir dans la douleur.
Depuis ma jeunesse, ce poème a toujours résonné dans mon cœur, comme une nostalgie.
Vive la Réunion !!! l’auteur décrit l’île comme un paradis et il a raison!