Las du triste hôpital et de l’encens fétide
Qui monte en la blancheur banale des rideaux
Vers le grand crucifix ennuyé du mur vide,
Le moribond, parfois, redresse son vieux dos,
Se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture
Que pour voir du soleil sur les pierres, coller
Les poils blancs et les os de sa maigre figure
Aux fenêtres qu’un beau rayon clair veut hâler,
Et sa bouche, fiévreuse et d’azur bleu vorace,
Telle, jeune, elle alla respirer son trésor,
Une peau virginale et de jadis ! encrasse
D’un long baiser amer les tièdes carreaux d’or.
Ivre, il vit, oubliant l’horreur des saintes huiles,
Les tisanes, l’horloge et le lit infligé,
La toux ; et quand le soir saigne parmi les tuiles,
Son œil, à l’horizon de lumière gorgé,
Voit des galères d’or, belles comme des cygnes,
Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir
En berçant l’éclair fauve et riche de leurs lignes
Dans un grand nonchaloir chargé de souvenir !
Ainsi, pris du dégoût de l’homme à l’âme dure
Vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits
Mangent, et qui s’entête à chercher cette ordure
Pour l’offrir à la femme allaitant ses petits,
Je fuis et je m’accroche à toutes les croisées
D’où l’on tourne le dos à la vie, et, béni,
Dans leur verre, lavé d’éternelles rosées,
Que dore la main chaste de l’Infini
Je me mire et me vois ange ! et je meurs, et j’aime
— Que la vitre soit l’art, soit la mysticité —
À renaître, portant mon rêve en diadème,
Au ciel antérieur où fleurit la Beauté !
Mais, hélas ! Ici-bas est maître : sa hantise
Vient m’écœurer parfois jusqu’en cet abri sûr,
Et le vomissement impur de la Bêtise
Me force à me boucher le nez devant l’azur.
Est-il moyen, ô Moi qui connais l’amertume,
D’enfoncer le cristal par le monstre insulté,
Et de m’enfuir, avec mes deux ailes sans plume
— Au risque de tomber pendant l’éternité ?
Stéphane Mallarmé, Vers et Prose, 1893
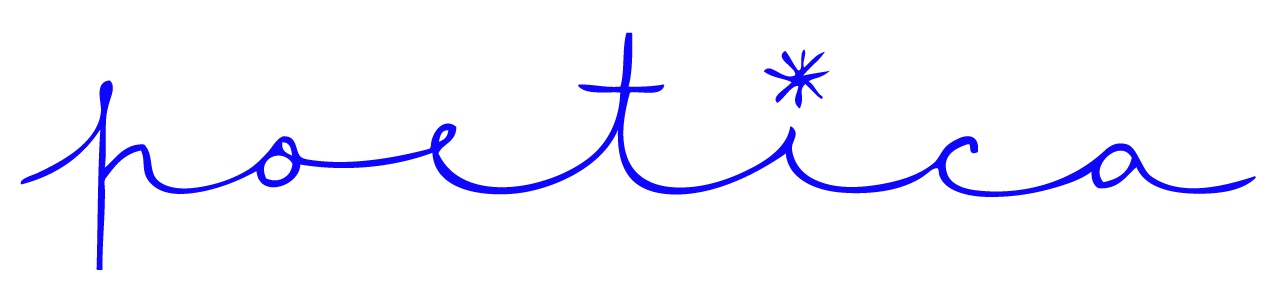

A Liliane (toujours au sujet de l’utilité de « l’analyse » littéraire)…
« Pas d’analyse, surtout pas d’analyse ! », dites-vous…
——————–
(Suite 3) « L’analyste », pas plus que le poète, ne doit nommer ni conceptualiser : il doit révéler, mettre en pleine lumière la structure de l’oeuvre, sa « forme » qui est sa profondeur et son essence, à l’aide des outils de l’analyse littéraire et linguistique…
Dans « Aube » de Rimbaud (où la Poésie se représente et se met en scène comme nulle part ailleurs) aucun être précis n’apparaît : l’outil littéraire favori du poète est ici la synecdoque qui n’est pas une « image » mais un procédé technique littéraire qui permet d’évoquer le tout par sa partie ou vice versa (rapport d’inclusion et non pas d’analogie) : « les camps d’ombre » pour les brumes, » les haleines » pour les animaux, « les pierreries » pour les multiples éclats de lumière dans le sous-bois, « les ailes » pour les oiseaux etc. ; c’est précisément l’évocation d’un monde matutinal d’avant l’apparition du concept, un monde éclaté et fragmenté que la poésie n’a pas encore éveillé ni unifié…
Le « wasserfall blond » (« chute d’eau ») lui-même, par sa sonorité étrange et barbare, agit davantage comme une onomatopée mystérieuse et primitive, un cri de la forêt auquel répond le rire dionysiaque du poète, que comme un concept.
La « fleur dit son nom » mais le poète le tait à dessein, puisque ce qui compte n’est pas de nommer, comme le ferait avec précision un botaniste, mais de mettre en scène l’acte poétique par excellence (le « dire ») qui est élan vers la lumière par la parole, et non fixation sur l’objet en lui-même.
C’est le poète-enfant, mendiant et suprême savant, qui est le dieu créateur d’un nouveau monde par la magie de son Verbe, c’est lui qui met ce monde en mouvement par sa course, « lève les ailes et les voiles » pour les réunir en pleine lumière « en haut de la route », au-dessus du bois sombre, par-delà les « quais de marbre », « amassées » enfin par la grâce de l’écriture au pied de l’Aube naissante que le poète peut enfin « entourer » de ses bras avant de « sentir un peu son immense corps » : cela n’a été rendu possible que grâce au double mouvement vers le haut et vers l’unité imposé par le poème.
Seule cette synthèse ascensionnelle et spirituelle vers le Un que permet l’écriture poétique a permis au poète « d’embrasser l’aube d’été », de la conquérir au sens le plus amoureux et chevaleresque du terme (amour qui est révélation) et de pousser ce cri de victoire inaugural : « J’ai embrassé l’aube d’été », victoire poétique que symbolise à la perfection le « bois de lauriers » tout proche…
L’analyse va aussi permettre de situer le poème dans l’oeuvre, de faire des rapprochements : il s’agit bien d’un conte, genre littéraire repris ailleurs dans le recueil : « Il était une fois l’Aube et l’Enfant… », et donc d’un récit à la fois merveilleux et tragique -qui va s’écrire à un temps du passé- à portée édificatrice : plus haut et exaltant est l’envol, plus tragique et douloureuse est la chute…
Et comment ici ne pas évoquer « Les Fenêtres » de Mallarmé ?
Ici aussi il est question d’envol et de chute icarienne in fine, ici aussi un idéal spirituel est brisé à la fin du poème, par la « Bêtise » humaine dans « Les Fenêtres », par la meurtrière et verticale lumière du « Midi » dans « Aube ».
Dans les deux cas il est question de quête ascensionnelle et spirituelle vers la lumière et l’azur, rendue possible dans et par le poème comme lieu privilégié de la création où tout est possible au poète démiurge…
Pour Mallarmé une « fenêtre », avec sa vitre (ses « carreaux »), n’est ni plus ni moins qu’un cadre délimitant une surface plane (le verre) qui laisse passer la lumière et à travers laquelle va pouvoir se lire artistiquement toute la profondeur du « ciel antérieur où fleurit la beauté », comme la profondeur de l’écriture poétique entourée de blanc s’écrit sur une feuille de papier plane ou encore l’oeuvre picturale s’étale sur une toile délimitée par un cadre : la « fenêtre », c’est le poème tout simplement (« art ou mysticité ») dans lequel le poète projette tout son être en visant (rêvant ?) l’Idéal, de la même façon qu’il aperçoit son reflet et se prend pour un « ange » en se « mirant » dans le carreau de verre tout en contemplant l’infini…
Le poème construit un monde, crée l’aube ou reflète l’infini… mais quoi de plus fragile que quelques gouttes d’encre jetées sur une feuille de papier ?
C’est là tout le paradoxe de l’oeuvre d’art, immense dans sa fragilité même, à cause de sa fragilité même, comme la vie…
Voilà, Liliane, ce que peut dire une amorce d' »analyse », succincte et comparative (à compléter), sans rien enlever au mystère de l’oeuvre je pense, mais au contraire en en faisant apparaître les différentes facettes, en ouvrant des perspectives de lecture infinies que ne donne pas le poème explicitement, même s’il porte à les penser, et c’est là le propre de toute poésie : « élan dans les mots vers plus que les mots », comme le dit magnifiquement Yves Bonnefoy…
« L’analyse », c’est en quelque sorte une aide à la lecture, une lecture continuée et amoureuse qui doit aider chacun à mieux lire le poème, entraîner chacun dans l’approfondissement de la lecture et à laquelle chacun peut apporter sa contribution dans l’intérêt général et au plus grand bénéfice de l’oeuvre et de sa richesse…
Le dernier mot est et reste évidemment au poème lui-même, auquel on doit obstinément revenir après et pendant la lecture de toute « analyse ».
Je finirai par l’argument d’autorité, qui n’est pas le moindre, pour défendre l’importance et l’intérêt de « l’analyse » : beaucoup de grands poètes ont été des critiques d’art et de poésie éclairés, la critique n’ayant en rien amoindri leur inspiration poétique, leur permettant bien au contraire d’acquérir une plus grande conscience de leur art : de Baudelaire à Jaccottet, en passant par Hugo, Mallarmé, Breton, Apollinaire, Ponge, Bonnefoy et tant d’autres…
Je vous laisse juge.
Le paradoxe avec la poésie est qu’on la dénude non pas en lui enlevant ses « voiles » (ce qui la détruirait), mais au contraire dans et avec ses « voiles » qu’il convient, dans « l’analyse », de mettre en pleine lumière poétique et de rendre visibles et lisibles, sans en ôter le mystère : comprenne qui pourra…
C’est ainsi qu’il faut sans doute comprendre le si beau poème de Rimbaud des « Illuminations » : « Aube ».
Je vous soumets cette « analyse » à titre d’illustration : l’Enfant qui court après l’Aube (l’autre nom de la Poésie) sur les quais de marbre « lève un à un les voiles » mais ne les enlève pas : il les retrouvera à la fin du poème…
En effet, au terme de la quête ascensionnelle, poétique et spirituelle, il entoure l’Aube « avec ses voiles amassés » (c’est à dire « rassemblés », « réunis »), et c’est alors seulement qu’il peut sentir « son immense corps » :
la Poésie se com-prend donc « avec ses voiles », c’est à dire l’ensemble de tous ses ornements pris au sens large, de tous ses mots, ses images, ses constructions métriques etc. mis ici en pleine clarté dans et par le poème, pour qui sait les voir et les « analyser » : l’Aube se retire progressivement vers la montagne entraînant, je dirais plutôt attirant l’enfant-poète à sa suite, Enfant qui a paradoxalement le pouvoir sur cette levée du jour naissant par l’action poétique (c’est lui qui « lève les voiles »), jusqu’à la rencontre suprême, illuminative, « en haut de la route », où toutes les brumes matutinales se sont résorbées (« amassées ») dans la pleine lumière du soleil triomphant, celui de l’Aurore : le poète est alors arrivé à la pleine maîtrise et conscience poétique et il tombe inconscient « au bas du bois », ébloui par la révélation, et avec lui le lecteur initié devenu poète à sa suite…
La lumière verticale du « midi » signifie la disparition définitive des « voiles » et donc la mort de la poésie… avec la fin du poème et le réveil du poète.
Liliane,
« Pas d’analyse, surtout pas d’analyse ! ».
Pourquoi cette frayeur ici devant « l’analyse » ? Rien ne vous oblige à la lire au demeurant…
Vous avez raison la poésie se goûte avant toute chose, et l’analyse littéraire ne doit pas ôter ce « goût » mais le démultiplier, ouvrir de nouvelles perspectives insoupçonnées tout en préservant le mystère.
Comme l’écrit magnifiquement Deleuze dans son « Proust et les signes », qui va dans le sens de vos réserves : « […] plus important que la pensée, il y a « ce qui nous donne à penser » (Proust) ».
Et cependant la poésie, dont l’outil principal est le mot, à la différence peut-être de la peinture ou de la musique ne peut se passer de tout « sens », à condition que ce sens soit approché à un niveau qui n’est pas celui de la pure et plate logique rationnelle et conceptuelle (la « signification » univoque) mais à un niveau qui soit polysémique, c’est à dire déjà poétique…
Il est des poèmes dans lesquels l’on rentre immédiatement de plain-pied, dont on comprend (ou croit comprendre) le « sens », dont on goûte immédiatement la saveur et que l’on va déclamant sur le chemin…
Il en est d’autres obscurs, revêches, arides, abrupts, où l’on pressent cependant l’importance de ce qui y est dit mais dont on n’arrive pas à percer le mystère et qui nous laissent pour ainsi dire sur notre faim, au pied du mur.
L’analyse doit être un corps à corps amoureux avec le poème, qui ne doit pas le violenter mais le dénuder progressivement pour en admirer in fine l’incomparable beauté.
Le poème d’ailleurs qui se dissimule adroitement et coquettement derrière ses voiles, comme toute vérité qui se refuse tout en se donnant, invite le lecteur à ce dénuement qui est un dévoilement : il faut savoir lire les signes…
La poésie, comme la montagne, se gagne avec effort, elle est aussi une initiation, il faut apprendre à la lire, tout n’est pas donné immédiatement, même dans les poèmes que l’on pense immédiatement accessibles…
Je pense à la poésie moderne et contemporaine bien sûr, à Mallarmé ou Char par exemple, mais pas seulement : tous les poèmes sont concernés, même les plus limpides !
Méfiez-vous des eaux dormantes qui cachent parfois de mortelles profondeurs invisibles à l’oeil nu…
Lisez les analyses de Maurice Blanchot, de Jean-Pierre Richard ou de Todorov par exemple, et vous verrez que l’analyse atteint un niveau de lecture qui est déjà profondément poétique, un niveau qui recrée le poème en quelque sorte sans rien enlever à son mystère qu’il approfondit au contraire, qui relance sa dynamique et invite le lecteur à devenir lui-même poète à sa suite par sa propre lecture et sa propre analyse.
Bien entendu, toutes les analyses n’ont pas le même niveau et il en est beaucoup qui sont inabouties, imprécises, inexactes, et ne sont que « des mots » (au mauvais sens du terme), de vains mots…
Soyez alors indulgente : l’analyse, même si elle est un tâtonnement qui se solde par un échec, a du moins été une tentative courageuse de se mesurer au poème, une façon de manifester l’amour qu’on lui porte et de devenir un peu poète soi-même dans les traces du Poète, comme le discours théologique, s’il n’est pas pris bêtement au pied de la lettre, est peut-être aussi, et principalement, une façon amoureuse de parler de Dieu…
Je vous laisse juge.
Pas d’analyse, surtout pas d’analyse !
Poème représentatif de la phase baudelairienne de Mallarmé, avec une structure semblable à celle de l' »Albatros » : une allégorie exposée dans un premier temps, dont l’interprétation est donnée dans un second temps.
« Ainsi » (pour reprendre le connecteur logique explicatif du début de la sixième strophe) le moribond des cinq premières strophes qui bave à la fenêtre comme seule médication possible à son désespoir n’est autre que Mallarmé « pris du dégoût de l’homme » et qui « s’accroche à toutes les croisées » pour tourner le dos à la (fausse) vie et tenter de se sauver…
Les deux dernières strophes marquent une sorte d’épilogue douloureux à la grande vision de derrière la vitre qui se voulait salvatrice, son échec en quelque sorte (« Mais, hélas ! »), et évoquent la pensée qui caresse un moment le poète d' »enfoncer le cristal » de la fenêtre qui, d’ouverture au ciel qu’elle était au départ, est devenue prison de verre ne le protégeant même plus de la Bêtise envahissante du monde, et céder enfin à la tentation d’Icare…
A noter que le regard de Mallarmé aborde les fenêtres dans le sens inverse au regard de Baudelaire qui, lui, porte sa vue de l’extérieur vers l’intérieur, vers la vie intérieure et secrète qui se déroule dans la pièce sombre éclairée à la lumière de la chandelle.
Pour Mallarmé, au contraire, la fenêtre est ce qui ouvre au monde, elle est abordée de l’intérieur vers l’extérieur, vers le ciel et la Beauté, mais la beauté filtrée par le verre (le cristal) de la croisée : ce qui donne au spectacle sa dimension artistique ou mystique, et donc « civilisé », « humanisé » (traité par l’homme), spectacle aperçu au milieu d’un cadre ou vu à travers un vitrail.
Le poète y contemple d’ailleurs son image reflétée : « il se mire et se voit ange ».
Ouvrez la fenêtre, « enfoncez le cristal », et vous êtes alors dans la nature brute, sauvage, et plus rien ne vous empêche de faire le grand saut pour quitter la vision artistique ou mystique, et plonger dans la mort brutale…
Je voudrais pour finir m’attarder sur les deux moments qui sont les sommets de l’œuvre : les visions parallèles du moribond à la cinquième strophe, et du poète à la huitième.
Il y a d’abord ces « galères d’or, belles comme des cygnes, sur un fleuve de pourpre et de parfums » qui illuminent l’œil du moribond et le nôtre par la même occasion. La métrique y est parfaite, collant complètement à la syntaxe de la phrase : cette vision grandiose est statique et apaisée.
Et puis surgit de nulle part, comme une vague de fond, ce vers à couper le souffle du début de la huitième strophe : « Je me mire et me vois ange ! et je meurs et j’aime »…
Nous ne sommes plus dans la contemplation sereine de la vision précédente : ici il s’agit de l’élan spirituel de l’âme sortant d’elle-même pour rejoindre ce « ciel antérieur » (posé devant le poète au travers de la vitre, ou ciel platonicien ?) et s’unir à lui dans et par la vitre qui reflète le visage du poète.
Et là, la syntaxe n’est plus du tout en accord avec le mètre comme dans la vision précédente : le vers est tout mouvement, avec ce fantastique rejet à la césure de « ange », et sa voyelle nasalisée qui ouvre le souffle et exprime le saut, qui n’est pas celui de la mort abordé à la fin du poème, mais celui de la Vie, de « la vraie Vie qui est ailleurs » (comme dirait Rimbaud)… et tout ceci magnifiquement soutenu, relancé par cette polysyndète en « et » qui poursuit à l’infini la lancée et la montée vers la grande vision finale de la Beauté qui clôture la strophe : l’époptie !
Et il n’y a plus rien à rajouter…
Un poème riche en émotion qui invite a la réflexion à propos des fenêtres.
Bravo François !
Magnifique et intriguant, un poème qui interroge plus qu’il ne répond.