HISTOIRE RUSSE.
CONVERSATION AU BAL À PARIS.
___
I
UN FRANÇAIS.
Qui donc vous a donné ces bagues enchantées
Que vous ne touchez pas sans un air de douleur ?
Vos mains, par ces rubis, semblent ensanglantées.
Ces cachets grecs, ces croix, souvenirs d’un malheur,
Sont-ils chers et cruels ? sont-ils expiatoires ?
Le pays des Ivans a seul ces perles noires,
D’une contrée en deuil symboles sans couleur.
II
WANDA, grande dame russe.
Celle qui m’a donné ces ornements de fête,
Ce cachet dont un Czar fut le seul possesseur,
Ces diamants en feu qui tremblent sur ma tête,
Ces reliques sans prix d’un saint intercesseur,
Ces rubis, ces saphirs qui chargent ma ceinture,
Ce bracelet qu’émaille une antique peinture,
Ces talismans sacrés, c’est l’esclave ma sœur.
III
Car elle était princesse, et maintenant qu’est-elle ?
Nul ne l’oserait dire et n’ose le savoir.
On a rayé le nom dont le monde l’appelle.
Elle n’est qu’une femme et mange le pain noir,
Le pain qu’à son mari donne la Sibérie ;
Et parmi les mineurs s’assied pâle et flétrie,
Et boit chaque matin les larmes du devoir.
IV
En ce temps-là, ma sœur, sur le seuil de sa porte,
Nous dit : « Vivez en paix, je vais garder ma foi.
« Gardez ces vanités ; au monde je suis morte,
« Puisque le seul que j’aime est mort devant la loi.
« Des splendeurs de mon front conservez les ruines.
« Je le suivrai partout, jusques au fond des mines ;
« Vous qui savez aimer, vous feriez comme moi.
V
« L’empereur tout-puissant, qui voit d’en haut les choses,
« Du prince mon seigneur voulut faire un forçat.
« Dieu seul peut réviser un jour ces grandes causes
« Entre le souverain, le sujet et l’État.
« Pour moi, je porterai mes fils sur mon épaule
« Tandis que mon mari, sur la route du pôle,
« Marche et traîne un boulet, conduit par un soldat.
VI
« La fatigue a courbé sa poitrine écrasée ;
« Le froid gonfle ses pieds dans des chemins mauvais ;
« La neige tombe en flots sur sa tête rasée ;
« Il brise les glaçons sur le bord des marais.
« Lui de qui les aïeux s’élisaient pour l’empire,
« Répond : Serge, au camp même où tous leur disaient : Sire.
« Comment puis-je, à Moscou, dormir dans mon palais ?
VII
« Prenez donc, ô mes sœurs, ces signes de mollesse.
« J’irai dans les caveaux, dans l’air empoisonneur,
« Conservant seulement, de toute ma richesse,
« L’aiguille et le marteau pour luxe et pour honneur ;
« Et puisqu’il est écrit que la race des Slaves
« Doit porter et le joug et le nom des esclaves,
« Je descendrai vivante au tombeau du mineur.
VIII
« Là, j’aurai soin d’user ma vie avec la sienne,
« Je soutiendrai ses bras quand il prendra l’essieu.
« Je briserai mon corps pour que rien ne retienne
« Mon âme quand son âme aura monté vers Dieu ;
« Et bientôt, nous tirant des glaces éternelles,
« L’ange de mort viendra nous prendre sous ses ailes
« Pour nous porter ensemble aux chaleurs du ciel bleu. »
IX
Et ce qu’elle avait dit, ma sœur l’a bien su faire ;
Elle a tissé le lin, et de ses écheveaux
Espère en vain former son linceul mortuaire ;
Et depuis vingt hivers achève vingt travaux,
Calculant jour par jour, sur ses mains enchaînées,
Les grains du chapelet de ses sombres années.
Quatre enfants ont grandi dans l’ombre des caveaux.
X
Leurs yeux craignent le jour quand sa lumière pâle
Trois fois dans une année éclaire leur pâleur.
Comme pour les agneaux, la brebis et le mâle
Sont parqués à la fois par le mauvais pasteur.
La mère eût bien voulu qu’on leur apprît à lire,
Puisqu’ils portaient le nom des princes de l’empire
Et n’ont rien fait encor qui blesse l’Empereur.
XI
Un jour de fête on a demandé cette grâce
Au Czar toujours affable et clément souverain,
Lorsqu’au front des soldats seul il passe et repasse.
Après dix ans d’attente il répondit enfin :
« Un esclave a besoin d’un marteau, non d’un livre ;
La lecture est fatale à ceux-là qui, pour vivre,
Doivent avoir bon bras pour gagner un bon pain. »
XII
Ce mot fut un couteau pour le cœur de la mère ;
Avant qu’il ne fût dit, quand s’asseyait ma sœur,
Ses larmes sillonnaient la neige sur la terre,
Tombant devant ses pieds, non sans quelque douceur.
Mais aujourd’hui, sans pleurs, elle passe l’année
À regarder ses fils d’une vue étonnée ;
Ses yeux secs sont glacés d’épouvante et d’horreur !
XIII
LE FRANÇAIS.
Wanda, j’écoute encore après votre silence ;
J’ai senti sur mon cœur peser ce doigt d’airain
Qui porte au bout du monde à toute âme qui pense
Les épouvantements du fatal souverain.
Cet homme enseveli vivant avec sa femme,
Ces esclaves enfants dont on va tuer l’âme,
Est-ce de notre siècle ou du temps d’Ugolin ?
XIV
Non, non, il n’est pas vrai que le peuple en tout âge,
Lui seul ait travaillé, lui seul ait combattu ;
Que l’immolation, la force et le courage
N’habitent pas un cœur de velours revêtu.
Plus belle était la vie et plus grande est sa perte,
Plus pur est le calice où l’hostie est offerte.
Sacrifice, ô toi seul peut-être es la vertu !
XV
Tandis que vous parliez je sentais dans mes veines
Les imprécations bouillonner sourdement.
Vous ne maudissez pas, ô vous, femmes romaines !
Vous traînez votre joug silencieusement.
Éponines du Nord, vous dormez dans vos tombes,
Vous soutenez l’esclave au fond des catacombes
D’où vous ne sortirez qu’au dernier jugement.
XVI
Peuple silencieux, souverain gigantesque !
Lutteurs de fer toujours muets et combattants !
Pierre avait commencé ce duel romanesque :
Le verrons-nous finir ? Est-il de notre temps ?
Le dompteur est debout nuit et jour et surveille
Le dompté qui se tait jusqu’à ce qu’il s’éveille.
Se regardant l’un l’autre ainsi que deux Titans.
XVII
En bas, le peuple voit de son œil de Tartare
Ses seigneurs révoltés, combattus par ses Czars,
Aiguise sur les pins sa hache et la prépare
À peser tout son poids dans les futurs hasards.
En haut, seul, l’Empereur sur la Russie entière
Promène en galopant l’autre hache dont Pierre
Abattit de sa main les têtes de Boyards.
XVIII
Une nuit on a vu ces deux larges cognées
Se heurter, se porter des coups profonds et lourds.
Les hommes sont tombés, les femmes résignées
Ont marché dans la neige à la voix des tambours,
Et, comme votre sœur, ont d’une main meurtrie
Bercé leurs fils au bord des lacs de Sibérie,
Et cherché pour dormir la tanière des ours.
XIX
Et ces femmes sans peur, ces reines détrônées,
Dédaignent de se plaindre et s’en vont au désert
Sans détourner les yeux, sans même être étonnées
En passant sous la porte où tout espoir se perd.
À voir leur front si calme, on croirait qu’elles savent
Que leurs ans, jour par jour, par avance se gravent
Sur un livre éternel devant le Czar ouvert.
XX
Quel signe formidable a-t-il au front, cet homme ?
Qui donc ferma son cœur des trois cercles de fer
Dont s’étaient cuirassés les empereurs de Rome
Contre les cris de l’âme et les cris de la chair ?
Croit-on parmi vos serfs qu’à la fin il se lasse
De semer les martyrs sur la neige et la glace,
D’entasser les damnés dans un terrestre enfer ?
XXI
S’il était vrai qu’il eût au fond de sa poitrine
Un cœur de père ému des pâleurs d’un enfant,
Qu’assis près de sa fille à la beauté divine
Il eût les yeux en pleurs, l’air doux et triomphant,
Qu’il eût pour rêve unique et désir de son âme
Quelques jours de repos pour emporter sa femme
Sous les soleils du Sud qui réchauffent le sang ;
XXII
S’il était vrai qu’il eût conduit hors du servage
Un peuple tout entier de sa main racheté,
Créant le pasteur libre et créant le village
Où l’esclave tartare avait seul existé,
Pareil au voyageur dont la richesse est fière
D’acheter mille oiseaux et d’ouvrir la volière
Pour leur rendre à la fois l’air et la liberté ;
XXIII
Il aurait déjà dit : « J’ai pitié, je fais grâce ;
L’ancien crime est lavé par les martyrs nouveaux ; »
Sa voix aurait trois fois répété dans l’espace,
Comme la voix de l’ange ouvrant les derniers sceaux,
Devant les nations surprises, attentives,
Devant la race libre et les races captives :
« La brebis m’a vaincu par le sang des agneaux. »
XXIV
Mais il n’a point parlé, mais cette année encore
Heure par heure en vain lentement tombera,
Et la neige sans bruit, sur la terre incolore,
Aux pieds des exilés nuit et jour gèlera.
Silencieux devant son armée en silence,
Le Czar, en mesurant la cuirasse et la lance,
Passera sa revue et toujours se taira.
5 novembre 1847.
DIX ANS APRÈS.
____
UN BILLET DE WANDA
AU MÊME FRANÇAIS
À PARIS
De Tobolsk en Sibérie.
Le 21 octobre 1855, jour de la bataille de l’Alma.
Vous disiez vrai. Le Czar s’est tu. — Ma sœur est morte
Les serfs de Sibérie ont porté le cercueil.
Et les fils de la sainte et de la femme forte
Comme esclaves suivaient, sans nom, sans rang, sans deuil.
La cloche seule émeut la ville inanimée.
Mais, au sud, le canon s’entend vers la Crimée,
Et c’est au cœur de l’ours que Dieu frappe l’orgueil.
SECOND BILLET DE WANDA
AU MÊME FRANÇAIS
De Tobolsk en Sibérie.
Après la prise du fort Malakoff.
Sébastopol détruit n’est plus. — L’aigle de France
L’a rasé de la terre, et le Czar étonné
Est mort de rage. — On dit que la balance immense
Du Seigneur a paru quand la foudre a tonné.
— La sainte la tenait flottante dans l’espace.
L’épouse, la martyre a peut-être fait grâce,
Dieu du ciel ! — Mais la mère a-t-elle pardonné ?
Alfred de Vigny, Les Destinées : poëmes philosophiques, 1864
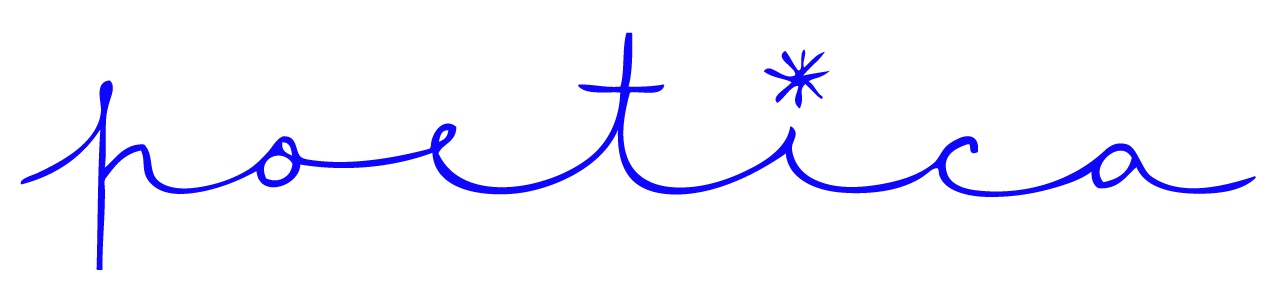

Constantinople
Le matin même de l’arrivée, nous avions passé la voiture sur la rive d’Asie et nous rôdions dans les ruelles du quartier de Moda en quête d’un logis qui nous fasse signe, quand une voix faible mais impérieuse qui nous interpellait en français nous fit retourner. C’était une grosse femme aux cheveux de neige qui portait une lourde broche d’améthyste sur un deuil élégant. Du haut de son perron elle examinait pensivement notre bagage, comme s’il lui rappelait quelque chose, et nous demanda ce que nous cherchions. Nous nous expliquâmes.
— J’ai fini ma saison la semaine dernière, mais j’ai gardé mes gens et j’aime assez les voyageurs. Vous pourrez loger ici. Et de son fume- cigarettes elle désigna au-dessus de l’entrée une petite inscription en lettres d’or Moda-Palas.
En silence, on transporta le bagage à travers une sombre salle à manger victorienne. Sur le dressoir, un chat moutarde dormait entre de flamboyantes théières de christofle. La chambre, qui donnait sur un jardin flétri, avait une légère odeur d’encaustique et de moisi distingué. Excepté une chambrière, le maître d’hôtel, et Mme Wanda, la patronne, l’hôtel était désert et, avec ses contrevents fermés, plus intimidant qu’un sépulcre. Nous nous surprenions déjà à baisser la voix, mais puisque le voyage passait par le Moda-Palas il n’y avait plus qu’à s’incliner. D’un côté, l’hôtel donnait sur la Marmara et l’île des Princes où l’on envoyait autrefois les prétendants turbulents en exil. De l’autre, il s’adossait à une colline d’où l’on apercevait la rive d’Europe étendue sous un ciel mauve, la Tour de Pera, et les bâtisses de la vieille ville avec leurs glycines en fleurs et leurs façades délabrées couleur de bois flotté.
— Qu’espérez-vous donc vendre ici? demanda encore la vieille en regardant l’enregistreur et le chevalet.
— De la peinture, des articles… une conférence peut-être.
— Avez-vous de la chance dans la vie ?
— Jusqu’à présent, oui.
— Ici, vous n’en aurez jamais trop, croyez-moi. C’est madame Wanda qui vous le dit.
Il y avait comme une trace de compassion dans sa voix.
Nicolas Bouvier, L’usage du monde, Ed. La Découverte, Paris, 1985; 2014.